|
Schizasteridae
Lambert, 1905, p.14
nomen transl.
Mortensen, 1951, p.204 ex. Schizasterinae Lambert in Doncieux, 1905
Genre type : Schizaster
Ag., 1836, p.185
Description succinte de la famille : Fasciole
péripétale et latéro-anal. Système apical ethmophracte à ethmolytique, avec
deux à quatre gonopores. Plastron mésamphisterne à holamphisterne.
Périprocte sur face postérieure tronquée.
|
|

 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
Genre
Schizaster
Agassiz,
1836
Prodrome d'une
monographie des radiaires, p.185
Espèce type
Schizaster studeri
Agassiz, 1836
Prodrome d'une
monographie des radiaires, p.209 (décision ICZN, 1948)
Extension
stratigraphique (bibliographique,
non vérifiée) : Cénomanien -
Actuel
Syn.
-
Paraster
Pomel, 1869, p.XIV ; espèce type :
Schizaster gibberulus
Agassiz,1847
-
Aplospatangus
Lambert, 1907, p.113 ; espèce type :
Schizaster eurynotus
Sismonda,1842
-
Prymnaster
Koehler, 1914, p.187 ; espèce type :
Prymnaster angulatus
Koehler,1914, p.187
-
Rotundaster
Lambert & Thierry, 1925,
p.526 ; espèce type : Schizaster foveatus
Agassiz,1889, p.350
-
Brachybrissus
Pomel, 1883, p.37 ; espèce type :
Spatangus ambulacrum
Deshayes,1831
|
|
|
|
|
|
diagnose originale du
genre par Agassiz |
|
Prodrome d'une
monographie des radiaires ou echinodermes, p.185 |
|
|
|
9.
Schizaster Ag. (Echinodardium
V. Ph. et Gr. - Spatangus De Bl. section B.) - Disque
cordiforme, très-élevé en arrière ; sillon bucco-dorsal long et
très-profond ; quatre autres sillons au sommet dorsal, profonds et
étroits, où sont cachés les ambulacres. Une espèce fossile et une
vivante. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
ambulacrum (Deshayes,1831) |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Cotteau |
|
Paléontologie
française terrains éocènes |
|
|
|
N° 87.
Schizaster ambulacrum (Deshayes),
Agassiz, 1860.
Pl. 95, et pl.
96.
18 (type de l'espèce) ; T. 42.
Espèce de taille assez forte, subcirculaire, de forme un peu
hexagonale, trapue, plus large que longue, arrondi et émarginée en
avant, étroite et acuminée en arrière. Face supérieure haute, renflée,
presque aussi élevée dans la région antérieure que dans l'aire
interambulacraire postérieure, ayant sa plus grande largeur vers le
milieu, au point qui correspond à l'appareil apical. Face inférieure
presque plane, arrondie sur les bords, un peu déprimée près du
péristome, surtout dans les aires ambulacraires paires antérieures,
qui paraissent lisses, à peine un peu bombée dans l'aire
interambulacraire impaire. Face postérieure tronquée verticalement,
fortement évidée au-dessous du périprocte. Sommet ambulacraire
subcentral. Sillon antérieur large, très excavé, caréné et subnoduleux
sur les bords, se rétrécissant et s'atténuant un peu vers l'ambitus,
se prolongeant jusqu'au péristome. Aire ambulacraire impaire munie, de
chaque côté, d'une rangée de petits pores s'ouvrant à la base de
l'excavation, écartés, séparés par un granule saillant et disposés par
paires obliques. De petites côtes granuleuses et transverses
s'intercalent entre chaque paire de pores et remontent sur la paroi de
l'excavation jusqu'au bord de l'aire ambulacraire. Chaque série se
compose de vingt-six ou vingt-sept paires depuis le sommet jusqu'au
fasciole ; les dernières paires s'espacent et deviennent moins
apparentes. Bien que notre exemplaire soit parfaitement conservé, nous
n'avons remarqué aucune trace d'une seconde série de petits pores qui
se montrent chez certaines espèces. Le milieu de l'aire ambulacraire
est très finement granuleux. Aires ambulacraires paires étroites,
fortement excavées, acuminées à leur extrémité, inégales, les aires
antérieures flexueuses, divergentes, beaucoup plus longues que les
aires postérieures, qui sont courtes, flexueuses, resserrées à
l'extrémité et relativement divergentes. Zones porifères assez larges,
placées sur les parois de l'excavation ambulacraire, formées de pores
ovales, unis par un sillon, disposés par paires transverses que sépare
une petite côte granuleuse, au nombre de vingt-neuf ou trente dans les
aires antérieures, de vingt environ dans les aires postérieures. Aux
approches du sommet, les pores des cinq ou six dernières paires
deviennent très petits, presque microscopiques. La différence entre
les zones porifères antérieures et postérieures, dans les aires
ambulacraires paires antérieures, est à peine sensible. Zone
interporifère se rétrécissant aux deux extrémités, vers le milieu, à
peu près de même étendue que l'une des zones porifères. Tubercules
très fins, serrés, homogènes sur toute la face supérieure, un peu plus
gros vers le bord du sillon antérieur, au sommet des aires
interambulacraires et surtout à la face inférieure. Aires
interambulacraires antérieures saillantes, carénées et subnoduleuses
près du sommet. Péristome excentrique en avant, semi-circulaire,
fortement labié, la lèvre bordée d'un bourrelet très apparent. Les
aires ambulacraires paires antérieures forment, de chaque côté du
péristome, une dépression allongée, subanguleuse, plus accentuée que
dans aucune autre espèce. Périprocte arrondi, très largement ouvert,
placé à la base de la carène dorsale, au sommet d'une aréa lisse et
évidée. Appareil apical peu distinct, paraissant pourvu de quatre
pores génitaux. Fasciole péripétale sinueux, suivant de près les aires
ambulacraires, s'élargissant à leur base, formant en arrière un angle
qui pénètre dans l'aire interambulacraire postérieure. Fasciole latéro-sous-anal
très étroit, non flexueux, se détachant du fasciole péripétale en
arrière des aires ambulacraires paires antérieures, à peu près au
quart de leur longueur.
Type de l'espèce : hauteur, 32 millimètres ; diamètre
antéro-postérieur, 48 millimètres ; diamètre transversal, 50
millimètres.
Individu de grande taille ; hauteur ? ... ; diamètre
antéro-postérieur, 59 millimètres ; diamètre transversal, 60
millimètres.
|
|
Rapports et différences.
- Cette curieuse espèce ne saurait être confondue avec aucune autre ;
elle se distingue nettement de ses congénères par sa forme
subcirculaire, légèrement hexagonale, par sa face supérieure aussi
élevée en avant qu'en arrière, par son sommet central, par ses aires
ambulacraires paries étroites, excavées, très acuminées, par son
péristome fortement labié et remarquable par la dépression des aires
ambulacraires paries, et surtout par l'énorme développement de son
périprocte régulièrement arrondi.
Histoire. - Cette espèce
a été signalée pour la première fois, en 1831, par Deshayes qui en
donne une figure assez médiocre et pas de description. Bien que
mentionnée comme une espèce caractéristique du terrain nummulitique
des Pyrénées, cette espèce est extrêmement rare, et deux échantillons
seulement jusqu'ici ont été rencontrés en France, celui qui a servi de
type à l'espèce, provenant de Biarritz, et un autre trouvé depuis, de
taille plus forte et de la même localité. L'espèce est tellement rare
que d'Archiac (loc. cit.), tout en la mentionnant,, met en
doute son existence à Biarritz ; mais la couleur, l'aspect de la roche
et le second exemplaire recueilli depuis ne peuvent laisser aucune
incertitude sur la provenance. Les exemplaires du Vicentin, figurés
par Dames, appartiennent bien certainement à l'espèce qui nous occupe.
Localité. - Biarritz (Phare Saint-Martin), d'après la roche)
(Basses-Pyrénées). Très rare. Eocène supérieur.
Ecole des mines de Paris (coll. Deshayes et michelin).
Localités autres que la france.
- Scaranto, Montecchio Maggiore, Priabona, S. Florano, Senago, Monte
Colombara, Arziano près d'Avesa (Verone). Penguente, Punta grossa,
Muggia (Istrie). Eocène.
Explication des figures.
- Pl. 95, fig. 1, S. ambulacrum, de la collection de l'Ecole
des mines de Paris, type de l'espèce, vu de côté ; fig. 2, face
supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, face postérieure ; fig.
5, portion de l'aire ambulacraire impaire grossie ; fig. 6, plaques de
l'aire ambulacraire impaire très fortement grossies. - Pl. 96, fig. 1,
aires ambulacraires paires grossies ; fig. 2, exemplaire de grande
taille, de la collection de l'Ecole des mintes de Paris, vu sur la
face inférieure ; fig. 3, plaques ambulacraires prises vers l'ambitus,
grossies.
Pl. 95 et 96 (extrait)
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Cahuzac & Roman, 1994,
Les
échinoides de l'Oligocène supérieur (Chattien) des Landes
(Sud-Aquitaine, France), p.362 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
ambulacrum (Deshayes,1831) -
Lutétien, Italie, 50 mm |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster angustistella
Lambert,1907 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Lambert,1907 |
|
Description des
échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, part.1, p.72 |
|
|
|
Schizaster angustistella
Lambert.
(Pl. IV, fig. 5 à 7)
On rencontre dans les calcaires marneux du Tongrien du Cap Sant' Elia
un petit Schizaster moins globuleux, moins renflé que le
précédent et que ses pétales ambulacraires beaucoup plus étroits ne
permettent pas de confondre avec lui.
Test de petite taille, mesurant 27mm de longueur sur 24mm
de largeur et 13mm de hauteur, rappelant un peu la forme
générale du S. Desori, mais en différant par ses ambulacres
plus courts et bien plus étroits, présentant ainsi une physionomie
très particulière qui ne permet de le confondre avec aucune autre des
espèces de Sardaigne.
Localité : Calcaire marneux du Cap Sant' Elia ; étage Tongrien. |
|
planche IV
(extrait)
|
|
|
|
|
holotype, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Lambert, 1907,Description
des échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, p.72 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster angustistella
Lambert,1907 - Miocène,
Oristano, Sardaigne, Italie, 36 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
archiaci
Cotteau,1863 |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Cotteau |
|
Paléontologie
française terrains éocènes, tome I, p.278 |
|
|
|
N° 71. Schizaster
archiaci, Cotteau, 1863
Pl. 83 et pl.
84, fig.1 et 2.
Espèce de taille moyenne, allongée, ovoïde, étroite, arrondie,
émarginée en avant, subacuminée postérieurement, ayant sa plus grande
largeur vers le milieu de sa longueur, plutôt un peu en arrière. Face
supérieure renflée, régulièrement déclive dans la région antérieure,
ayant sa plus grande hauteur en avant de l'appareil apical, subcarénée
en arrière. Face inférieure arrondie au pourtour, régulièrement
bombée, renflée surtout dans l'aire interambulacraire impaire. Face
postérieure tronquée et même un peu évidée au-desous du périprocte.
Sommet ambulacraire très excentrique en arrière. Sillon antérieur
allongé, étroit, assez profond, excavé et subcaréné sur les bords,
s'atténuant vers l'ambitus qu'il échancre légèrement, disparaissant
aux approches du péristome. Aire ambulacraire impaire étroite, formée
de pores petits, simples, séparés par un léger renflement
granuliforme, disposés de chaque côté sur une seule rangée par paires
espacées, d'autant plus écartées qu'elles se rapprochent de l'ambitus.
Aires ambulacraires paires étroites, fortement creusées, inégales, les
aires antérieures allongées, flexueuses, rapprochées du sillon
antérieur, les aires postérieures beaucoup plus courtes, moins
flexueuses et plus arquées. Zones porifères larges, composées de pores
allongés, inégaux, les internes arrondis, les externes plus étroits,
plus longs, unis par un sillon, s'ouvrant sur les parois de
l'excavation, disposés par paires transverses, au nombre de trente et
une ou trente-deux, dans les zones porifères des aires antérieures, au
nombre de vingt et une ou vingt-deux dans les aires postérieures. Zone
interporifère presque nulle. Aires interambulacraires resserrées et
saillantes autour du sommet. Tubercules petits et homogènes sur une
grande partie de la face supérieure, plus développés sur le bord du
sillon antérieur, et à la face inférieure. Péristome très excentrique
en avant, semi-circulaire, à fleur de test, pourvu d'une lèvre
saillante. Périprocte ovale, longitudinal, placé au sommet de la face
postérieure. Fascioles à peine distinctes.
Individu de taille moyenne, type de l'espèce : hauteur, 25 millimètres
; diamètre antéro-postérieur, 33 millimètres ; diamètre transversal,
29 millimètres.
Exemplaire de taille plus forte : hauteur, 31 millimètres ; diamètre
antéro-postérieur, 45 millimètres ; diamètre transversal, 40
millimètres.
Variété plus large : hauteur, 25 millimètres ; diamètre
antéro-postérieur, 40 millimètres ; diamètre transversal, 35
millimètres.
Cette espèce présente quelques variations de peu d'importance, mais
qu'il est cependant intéressant de constater : la forme générale est
plus ou moins ovoïde, et son diamètre transversal plus ou moins étendu
; la face supérieure est toujours un peu relevée et acuminée en
arrière. Nous avons fait figurer un exemplaire du Muséum de Paris
(Collection d'Orbigny), chez lequel la plus grande hauteur est non pas
en avant, comme dans le type, mais en arrière de l'appareil apical. Le
sommet ambulacraire, ordinairement très excentrique en arrière,
paraît, dans les individus de grande taille, se rapprocher un peu plus
du centre. Malgré ces légères différences, tous mes exemplaires
présentent une grande uniformité dans leurs caractères principaux.
Rapports et différences.
- Cette espèce, dans l'origine, avait été confondue par d'Archiac avec
le S. vicinalis, de l'Eocène supérieur de Biarritz. Ainsi que
nous l'avons constaté, dès 1863, dans nos Echinides fossiles des
Pyrénées, le S. vicinalis se distingue nettement de
l'espèce qui nous occupe
|
|
Rapports et différences.
- Cette espèce, dans l'origine, avait été confondue par d'Archiac avec
le S. vicinalis, de l'Eocène supérieur de Biarritz. Ainsi que
nous l'avons constaté, dès 1863, dans nos Echinides fossiles des
Pyrénées, le S. vicinalis se distingue nettement de
l'espèce qui nous occupe par sa forme moins ovale et plus dilatée en
avant, par sa face supérieure plus rapidement déclive, par son sillon
antérieur plus large et plus profond, par ses aires ambulacraires
antérieures plus flexueuses. Le S. Archiaci se rapproche
davantage des individus de grande taille du S. Des Moulinsi ;
cette dernière espèce, cependant, s'en éloigne d'une manière
très positive par son sommet ambulacraire moins excentrique en
arrière, par son sillon antérieur plus large, plus profond, moins
saillant sur les bords, entamant plus fortement l'ambitus et se
prolongeant jusqu'au péristome, par sa face postérieure tronquée plus
verticalement. Notre espèce offre également quelques rapports avec le
S. acuminatus, de l'Eocène de Belgique ; elle en diffère par sa
forme plus ovoïde, par son sommet plus excentrique en arrière, par son
sillon antérieur plus ou moins large, plus atténué vers l'ambitus, par
ses aires ambulacraires paires antérieures plus étroites, par sa face
postérieure plus acuminée, plus rentrante, tronquée moins
verticalement. Les exemplaires du Vicentin, figurés par M. de Loriol
et plus tard par M. Bittner, paraissent bien appartenir à cette même
espèce.
Localité. - Saint-Palais
(Charente-Inférieure). Assez rare. Eocène moyen.
Muséum de Paris (coll. d'Orbigny) ; coll. Hébert, Ducrocq, Croizier,
Degrange-Touzin, ma collection.
Localités autres que la France.
- Blangg (Schwitz) ; Gran Croce di Giovani Ilarione (Vicentin).
Eocène.
Explications des figures.
- Pl. 83, fig. 1, S. Archiaci, de ma collection, vu de côté ;
fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, face
antérieure ; fig. 5, autre exemplaire, de la collection d'Orbigny,
variété plus dilatée, vu de côté ; fig. 6, face supérieure ; fig. 7,
face postérieure. - Pl. 84, fig. 1, exemplaire de grande taille, de la
collection de M. Degrange-Touzin, vu sur la face supérieure ; fig. 2,
aire ambulacraire impaire grossie.
Pl. 83 et 84 (extrait)
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Cotteau, 1887,
Paléontologie française - Terrain Tertiaire - Echinides éocènes,
t. 1, p.277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
archiaci
Cotteau,1863 -
Lutétien, Italie, 36 mm |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
armiger
Clarck,1915 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Clark |
|
The Mesozoic and
Cenozoic Echinodermata of the United States, p.152 |
|
|
|
Schizaster armiger
Clark, n. sp.
Plate LXX,
figures 1a-d.
Determinative characters. - Test rather large, cordiform,
depressed upper surface slopes at first rapidly then more slowly from
anterior margin to apical system, beyond which an elevated sharp ridge
continues to the truncated posterior margin. Ambulacra in broad deep
furrows, the paired ambulacra in moderately sunken petals, the
anterolateral being about one and one-half times al long as the
posterolateral. Peripetalous and lateral fascioles distinct.
Dimensions. - Length 53 millimeters ; width 46 millimeters ;
height 22 millimeters.
Description. - This species has a test of moderately large
size, much depressed and clearly cordiform in marginal outline. The
upper surface slopes at first rapidly from a sharp anterior margin to
near the apical system when it becomes nearly flat for a short
distance. Beyond the apical system a sharp elevated ridge highest near
the middle point continuous on to the truncated posterior margin.
The ambulacra are broad, the single anterior ambulacrum being situated
in a deep broad groove that deeply indents the anterior margin. The
paired ambulacra have broad deep petals, the anterolateral being
somewhat over one and a half times as long as the posterolateral.
|
|
The interambulacra are more or less flat, slightly gibbous, the
posterior much elevated forming a sharp ridge. The surface is thickly
covered with small perforate tubercles. The peripetalous and lateral
fascioles are very distinct.
The peristome is near the anterior margin in a shallow depression. The
periproct is high on truncated posterior margin.
Locality. - Cocoa post office, Choctaw County, Ala.
Geologic horizon. - St. Stephens limestone (lower part), upper
Eocene.
Collection. - U.S.National Museum (141104).
Pl. LXX
(extrait)
|
|
|
|
|
Holotype, conservé
au Smithsonian National Museum of Natural History |
|
figuré in
Clark in
Clark & Twitchell, 1855, Mesozoic and
Cenozoic Echinodermata of the United States, p.152 |
|
|
| Catalog Number: |
USNM MO 141104 |
| Collection Name: |
Echinodermata Echinoidea Type |
| Scientific Name (As Filed): |
Schizaster (Paraster) armiger
Clark in Clark & Twitchell |
| Type Status: |
Holotype |
| EZID: |
| |
http://n2t.net/ark:/65665/367cef851-ed96-471e-9fd5-d52fbe3e0e89 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| |
Schizaster
armiger
Clarck,1915 -
Eocène, Ocala limestone, Floride, 51 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster barcinensis
Lambert,1907 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Lambert, 1907 |
|
Description des
échinides fossiles de la province de Barcelone, p.118 |
|
|
|
SCHIZASTER
BARCINENSIS Lambert
(Pl. VI, fig.
2, 3)
Schizaster
Scillae Almera (non Des Moulins) : Reconoc. pres. d. prim. Mediterr.
in el Panades, p.2, 8, 16 - 1897.
- -
Almera : B. S. G. F., (3), XXVI, p.817, 821 - 1898.
Espèce de moyenne taille (longueur 45mm., largeur 43, haut. 35)
renflée, presque subglobuleuse, acuminée en arrière et ayant son
sommet près et en arrière de l'apex, déclive en avant, à peu près
uniformément bombée en dessous. L'apex, dont les détails sont peu
distincts est médiocrement excentrique en arrière et paraît n'avoir
porté que deux pores génitaux. Le sillon se creuse en-dessus en une
large fosse allongé, à bords un peu surplombants, rétrécie aux
approches de l'ambitus, échancre sensiblement le bord et disparaît
presque avant d'atteindre le péristome qui est assez rapproché du
bord. Les ambulacres pairs sont relativement courts, très inégaux,
assez larges, peu divergents, arrondis à leur extrémité, très rétrécis
et comme atrophiés au voisinage de l'apex et c'est seulement à une
petite distance de ce dernier qu'ils s'élargissent en pétales et se
creusent assez profondément. Le fasciole péripétale bien distinct,
très coudé, est en avant oblique au grand axe du test, et des
extrémités des ambulacres pairs gagne presque directement le sillon
antérieur au point où il se rétrécit.
Cette espèce est évidemment voisine du Sch. eurynotus ; elle
s'en distingue cependant par sa forme plus courte et plus renflée,
moins rétrécie en arrière, par son sillon plus large, mais moins
excavé en-dessus, par ses ambulacres pairs plus courts, plus larges et
plus divergents, par son fasciole oblique et non transverse en avant. |
|
Le Sch. Karreri Laube, à peu près de même taille, est moins
renflé, moins acuminé en arrière ; il a son apex plus excentrique :
ses ambulacres pairs sont plutôt effilés qu'arrondis à leur extrémité
et les antérieurs sont encore plus larges. Le Sch. barcinensis
ne saurait en résumé être confondu avec aucune des espèces miocènes
jusqu'ici figurées.
Localité. - Burdigalien supérieur de Monjos, station de
Calafell, St vincent de Bara. - Collection J. Almera.
Pl. VI
(extrait)
|
|
|
|
|
syntype, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Lambert, 1907, Description des
échinides fossiles de la province de Barcelone, p.118 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster barcinensis
Lambert,1907 -
Burdigalien, Barcelone, Espagne, 50 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
calceolus
Lambert,1907 |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Lambert |
|
Description des
échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, 1907, p.69 |
|
|
|
Schizaster calceolus
Lambert, 1907
(Pl. V,
fig. 8).
synonymie
1907. Schizaster
calceolus, Lambert, description des Echin. foss. de la prov. de
Barcelone, fasc. 2, Echin. des terr. miocènes, p.118.
Longueur : 52mm, larg. 47mm, haut. 30mm.
Test polygonal, ovalaire, à peu près également rétréci en avant et en
arrière, acuminé de ce côté, déclive en avant et face inférieure
plane.
Apex subcentral, à deux pores génitaux. Sillon antérieur large et très
profond, au point de donner au test un aspect calcéolé particulier ;
ce sillon entame très profondément l'ambitus et disparaît en dessous
avant d'atteindre le péristome.
Les pores de l'ambulacre impair sont sur les bords du sillon que
recouvre un peu l'interambulacre, réduit entre les ambulacres
antérieurs pairs à une crête étroite et surplombante. Amaulacres
pairs, courts, profonds, inégaux, les antérieurs peu divergents, les
postérieurs très réduits.
Péristome assez éloigné du bord, à labrum peu saillant. Périprocte
postérieur, ovale, assez élevé, dominant un area distinct.
|
|
Tubercules très petits et serrés ; un peu plus développés en dessous.
Fasciole circonscrivant de très près les pétales, mais passant en
avant obliquement et directement de l'extrémité des pétales antérieurs
pairs au bord du sillon, qu'il traverse, sans en suivre la crête et
sans former le coude caractéristique du S. eurynotus.
En raison de son apex subcentral, de son énorme sillon et de ses
courts ambulacres cette espèce ne me paraît pouvoir être confondue
avec aucune autre.
Localités : Grès de la
tranchée de Bonorva ; étage Langhien - Monte Alvu ; étage Helvétien.
Pl. V
(extrait)
|
|
|
|
| |
Schizaster
calceolus
Lambert,1907 -
Helvétien, Thiesi, Sardaigne, 77 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
calceolus
Lambert,1907 -
Burdigalien, Sardaigne, 53 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
cavernosus
Pomel,1887 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Pomel |
|
Description des
animaux fossiles de l'Algérie, 2ème fascicule, 2ème livraison, 1887, p.76. |
|
|
|
schizaster cavernosus
A. Pl. XXV, fig. 6-8.
Longueur, 0m072
; largeur, 0m068 ; hauteur, 0m040.
- 0 039
- 0 036
- 0 023.
Grand oursin à pourtour presque en losange, longuement atténué en
avant et largement échancré, plus brièvement atténué à l'arrière et un
peu tronqué ; à la face supérieure brièvement retombante en arrière et
déclive en avant dans tout le reste de son étendue, médiocrement
épaisse à l'arrière, amincie à l'avant, la plus grande largeur étant à
la hauteur de l'apex et la plus grande hauteur à un centimètre de
l'extrémité postérieure, disposée en rostre peu saillant.
Apex un peu déprimé, à deux pores génitaux, excentrique en arrière
(3/5). Ambulacre antérieur formé de paires de pores serrées, en série
unique le long du pli des assules ambulacraires ; les pores sont
petits, séparés par un granule et il en part une strie qui remonte
jusqu'à la suture interambulacraire et paraît même se poursuivre sur
le fond du sillon. Celui-ci est très ample, très profond dès son
origine, un peu resserré vers l'avant qu'il échancre fortement et
au-dessous duquel il se prolonge en gouttière jusqu'à la bouche. Ses
parois verticales sont creusées en surplomb, formées dans la moitié
supérieure par une assez large bande de l'interambulacre rentrante
sous la marge, presque lisse et costulée sur les sutures. Ce sillon a
0,012 de large et autant de profondeur à une faible distance de son
origine.
Pétales fortement coudés assez loin de leur naissanc, puis presque
droits, courts, serrés contre le sillon impair, beaucoup moins creusés
que lui, divergeant entr'eux de 33° ; les postérieurs à fossette
ovale, n'ayant guère plus
|
|
du 1/3 de la
longueur des antérieurs. Fasciole péripétale serrant de près les
pétales, allant croiser le sillon impair près du bord.
Interambulacres antérieurs très étroits, saillants, en côte obtusément
carénée entre les sillons ; les latéraux assez longuement contractés
et peu gibbeux au sommet ; l'impair assez épais, caréné en toit, puis
obtusément à sa partie postérieure retombante.
Péristome assez éloigné du bord, en croissant à lèvre brisée,
faiblement déprimé au pourtour. Périprocte au sommet de la face
postérieure, sous un faible rostre (dans un jeune il est à fleur)
au-dessus d'une aréa mal conservée. Plastron un peu convexe, ample,
lancéolé angulairement, rétréci en arrière vers les 2/5 ; talon un peu
arrondi et pulviné et un peu proéminent en arrière. Fasciole
latéro-sous-anal mal conservé, naissant vers le milieu des pétales
antérieurs.
On arrivera peut-être à reconnaître que ce Schizaster n'est
qu'une monstruosité du S. barbarus, analogue à celle signalée
pour le S. saheliensis sous le nom de dilatatus. Une
simple comparaison des figures suffira du reste pour ne laisser aucun
doute sur la convenance de les distinguer au moins provisoirement.
Terrain helvétien : Envion d'Orléansville; Djebel Garibou.
|
|
|
|
| |
Schizaster
cavernosus
Pomel,1887 -
Miocène, Murcia, Espagne, 61 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster decipiens
Lambert,1908 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Lambert |
|
Description des
échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, 1908, p.74 |
|
|
|
Schizaster decipiens
Lambert.
(Pl. VI,
fig. 6, 7).
Test de moyenne taille, mesurant 37mrn de longueur sur 34 de largeur
et 24 de hauteur, subcordiforme, arrondi et légèrement échancré en
avant, un peu rétréci et subtronqué en arrière. Sillon antérieur
large, profond en dessus, rétréci et atténué à l'ambitus ; carène
postérieure assez sensible ; apex excentrique en arrière; pétales
pairs peu divergents, les antérieurs flexueux, peu longs mais assez
larges, les postérieurs très courts. Face inférieure à peine convexe,
avec péristome très excentrique en avant. Fasciole péripétale
paraissant assez liirge, faiblement coudé en avant, d'ailleurs peu
distinct.
Cette espèce, représentée seulement par trois individus assez
défectueux, avait été rapportée par Cotteau à. son S. Scillae,
c'est-à-dire au S. eurynotus ; mais il n'est pas possible de
maintenir cette détermination, car malgré un sillon antérieur assez
large et une carène assez saillante, le S. decipiens diffère
nettement de l'espèce provençale par sa taille moindre et son sillon
antérieur plus atténué, presque nul à l'ambitus; il est aussi plus
large en arrière et son apex est beaucoup moins excentrique. Ce
Schizaster se rapprocherait plutôt des S. barcinensis et
S. Parkinsoni, mais ce dernier plus grand, plus rétréci en avant,
a ses interambnlacres plus saillants en dessus, son sillon plus
profond à l'ambitus, son fasciole plus
|
|
développé.
Quant au S. barcinensis, il est plus large, son apex est plus
central, ses ambulacres postérieurs sont relativement plus longs et
son sillon échancre davantage l'ambitus.
localité. Calcaire
marneux de Cuccuruddu (Thiesi); étage Helvétien.
planche VI
(extrait)
|
|
|
|
| |
Schizaster decipiens
Lambert,1908 -
Lutétien, Italie, 44 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
depressum -
Lutétien, Italie, 44 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
desori Wright,1855 |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Lambert |
|
Description des
échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne, 1907, p.70 |
|
|
|
Schizaster Desori
Wright, 1855.
(Pl. V,
fig. 5).
Si l'on peut se faire une idée assez exacte de cette espèce d'après
les figures données, d'abord par Wright en 1855 (Foss. Echinod. of
Malta, pl. VI, fig. 3), puis par Manzoni en 1880 (Echin. coll. di
Bologna, taf.
III, fig. 29, 30), sa synonymie reste très incertaine en ce qui
concerne les citations sans figure données par les auteurs.
Cotteau n'en a signalé en Sardaigne que quelques individus douteux,
dont le moins mal conservé de l'Helvétien du Cap Sant'Elia, par sa
forme rétrécie en arrière, son sillon échancrant très peu l'ambitus,
son apex faiblement excentrique en arrière et ses ambulacres pairs
étroits, peu divergents, paraît en effet très voisin de l'espèce sans
que l'on puisse affirmer son identité.
Mais les individus les moins rares et les plus typiques proviennent
des marnes micacées du Langhien, où ils sont surtout fréquents à
l'état de moules.
Espèce de moyenne taille, mesurant 50mm de longueur, sur 48mm
de largeur et 31mm de hauteur, assez renflée, un peu
rétrécie et très acuminée en arrière, arrondie et à peine sinueuse en
avant. Sillon antérieur étroit, canaliforme en dessus, mais
s'atténuant beaucoup vers l'ambitus. Apex excentrique en arrière, avec
seulement deux pores génitaux. Ambulacres pairs inégaux, peu
divergents, les antérieurs étroits, flexueux, les postérieurs
relativement assez longs. Fasciole circonscrivant latéralement de très
près les pétales ; le latéral bien distinct, presque droit sur les
flancs, s'y tient assez haut, puis s'infléchit en U à la face
postérieure.
Je rapporte encore au S. Desori certains moules qui, malgré
leur compression, présentent bien les caractères de l'espèce ; mais il
faut pour leur détermination tenir largement compte des déformations
qu'ils ont subi.
|
|
Malgré la forme de son sillon et sa physionomie générale le S.
Desori paraît bien n'avoir que deux pores génitaux à l'apex. Il
n'appartient donc pas comme je le croyais et comme je l'ai dit dans ma
Description des Echinides fossiles de la province de Barcelone (fasc.
2, p. 113) à la section des Schizaster typiques ; et il serait
à reporter dans une section particulière, si toutefois ce caractère a
bien la valeur que l'on a voulu lui attribuer. Mais il semble que les
formes éocéniques à quatre pores en aient en quelque sorte
individuellement perdu deux vers le Miocène, sans que l'ensemble de
leurs caractères se soient d'ailleurs sensiblement modifié.
On trouve dans les calcaires marneux du Stampien de Cameseda (Ales)
une forme très voisine du S. Desori, mais dont le sillon paraît
encore plus atténué. Elle n'est malheureusement représentée que par
quelques rares individus en mauvais état et il ne m'est pas possible
de me prononcer d'une façon certaine sur l'exactitude de ce
rapprochement.
Localités : Marnes
Langhiennes de la tranchée de Bonorva (Sassari) et de Biugia Targesi (Fangario).
D'après un fragment de Fontanaccia l'espèce serait apparue dès
l'Aquitanien ; elle remonte d'après Cotteau jusque dans l'Helvétien du
Cap Sant' Elia. A Malte, elle est d'après Wright caractéristique de
son assise N° 4, c'est-à-dire du Langhien.
Pl. V
(extrait)
|
|
|
|
| |
Schizaster
desori Wright,1855 -
Middle Globigerina
Limestone, Miocène, Forna Point, Ile de Malte, 20 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
desori Wright,1855 - Upper Globigerina
Limestone, phosphorite conglomerate bed, Miocène, Ile de Malte, 20 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
eurynotus Sismonda,1842 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Sismonda |
|
Monografia degli
Echinidi fossili del Piedmonte, 1842, p.31 |
|
|
|
schyzaster eurynotus
Ag. tab. 2. fig. 2-3.
Schyzaster
ambitu ovato-cordato, postice elatus, productus, acute carinatus ;
ambulacris profunde impressis, posterioribus brevissimis, anticis
paribus longioribus et flexuosis, impari simplici, cunctis zonula
circumdatis, poris coniugatis ; canali antero patulo, valde excavato ;
ano ovato, fere sub carina dorsali ; ore prope marginem, labiato ;
basi subpulvinata.
|
Echinus ..... cordiformis ; lacuna media multum incavata,
longitudinali ; duabus lateralibus minoribus ; duabus aliis
minimis, fere marginalibus, gibba media extante prope anum
marginalem Bord.
Catal raisonn. p. 691. n. 28.
Spatangus globosus ?
Risso Europ. mérid.
t. 5. p. 281 n. 36.3
Schyzaster Eurynotus
Ag. Catal. syst.
ectyp. echin. foss. p. 2. - E. Sism. Monogr. echin. piem. p. 22. |
Lo Schyzaster Eurynotus si è una della più belle specie del suo
genere, e suol presental degli individui di piuttosto grossa tablia.
Forma un guscio ovale, cuoriforme, posteriormente bibboso, e terminato
in una cresta acutamente carenata ; sul dinnanzi è depresso, più
sottile, ed ampiamente e profondamente solcato dal canale bocco-dorsale,
in cui sta annidato l'ambulacro impari, fatto da pori semplici. Gli
ambulacri pari son pur essi impressi in altrettante lacune scavate sul
dorso del disco, differiscono in lunghezza essendo brevissimi i
posteriori, e lunghi ed arcuati gli anteriori, convergono al di là del
centro, e formano une stella circoscritta da une zona, o filetto
liscio ed impresso. Fori ambulacrali coniugati, ano ovale, scolpito
quasi al dissotto della cresta dorsale, bocca vicina al margine
anteriore, labiata, base un po' convessa, granulosa assai pei
tubercoli spiniferi quivi più numerosi, e più sviluppati.
|
|
Indotto in errore da un individuo schiacciato sui lati in modo a
mostrarsi posteriormente alquanto più acuto e carenato del solito,
citai questa specie nella Monograpfia degli Echinidi fossili del
Piemonte come propria del terreno mioceno del colle torinese ; un pi
severo esame, e'l paragone del fossile terziario col vero S.
Eurynotus della creta mi paleso la differenza, e mi fece vedere
che esso non è che un individuo mal conservato dello Schyzaster
canaliferus ; giova del resto confessare, che queste due specie
hanno tra loro molta analogia, e se si eccettui la cresta dorsale, che
è pronunciatissima nello S. Eurynotys, per gli altri caratteri
è difficile il distinguerle.
Abita . . . . . Fossile nella creta di Biarritz (Ag.) ed a Nizza
marittima in un terreno cretaceo superiore.
Pl. 2
(extrait)
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Vautrin, 1933,
Les
échinides burdigaliens de la zone désertique syrienne, p.114 |
|
|
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Cottreau, 1913,
Les
échinides néogènes du Bassin méditerranéen, p.114 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
eurynotus Sismonda,1842
-
Burdigalien inférieur, Lybie, 85 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster excavatus
Martin in
Jeannet & Martin,1937 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Martin in Jeannet & Martin,1937 |
|
Ueber Neozoische
Echinoidea aus dem Niederlandisch indischen Archipel, p.[292] |
|
|
|
Schizaster
excavatus
nov. spec. (R. Martin).
1. Schizaster cf.
canaliferus, v. Staff
u. Reck 1911, p.44 ;
Mittelpliozän ; Java, Trinil.
1, 2. Aus dem
Mittel pliozän der Umgegend von Trinil liegen mir zwei Exemplare einer
neuen Schizaster-Art vor. Das cine stammt aus der Sammlung dos
Berliner Museums (Abb. 62), das andere aus derjenigen des Mijnwezen
(B1. 93 B, 248; N. von Ngawi). Die Sehale ist länglieh und äusserst
flach ; die Maasse sind 47 X 36 X 24 mm, bezw. ± 56 X 45 X 30 mm. Das
vordere Ambulakrum ist sehr tief und breit, in der Mitte des Gehäuses,
gegen aussen hin etwas schmäler und untiefer werdend, also wie bei
S. progoensis. Auch die Form und Länge der seitliehen Ambulakren
sind wie hei dieser Art. Der Apex liegt weit nach hinten verschoben
und enthält wenigstens zwei Genitalporen. Die flache Oberseite der
Schale steigt von da an flach weiter, also ohne merklichen Kiel
zwischen den hinteren Ambulakren, bis zum ganz hinten gelegenen
Vertex. Die flach abgestutzte Hinterseite trägt in der Mitte den Anus.
Das Plastron auf |
|
der Oralseite ist schmal und
schwach gewölbt ; beiderseits gehen die Seiten schräg nach oben und
treffen an dem Ambitus scharfwinklig mit der Apikaiseite zusammen.
Peristom klein, dicht bei dem Einschnitt des unpaaren Ambulakrums
Fig. 62a,b
|
|
|
|
| |
Schizaster excavatus Martin
in Jeannet &
Martin,1937 - Miocène, Solo River, Central Java, Indonésie, 56 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
globulus Dames,1877 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Dames |
|
Die Echiniden der
vicentinischen und veronesischen Tertiaerablangerungen, 1877, p.57 |
|
|
|
S c h i z a
s t e r g l o b u l u s nov. sp.
Tafel IX, Fig.
5.
Schizaster Beloutschistanensis von Schauroth. Catalog p. 193 (ex
parte).
"
"
Laube. Vic. Ech. p. 31.
Länge 35 mm., Breite 31 mm., Höhe 26 mm.
Die kuglige, nussförmige Art besitzt einen fast regelmässig ovalen
Umriss, dessen grösste Breite mitten zwischen die hinteren
Interambulacralfelder fällt. Die Ränder sind bauchig aufgetrieben, die
Oberseite ist gleichmässig gewölbt, die Unterseite flach. Die grösste
Höhe liegt dicht vor dem Apex, der weit nach hinten gelegen ist. Von
ihm geht nach vorn eine im Anfang sehr tiefe, nahe dem Rande jedoch
nur noch schwache Ambulacralfurche aus, am Apex durch scharfe,
kammartig sich erhebende Theile der vorderen Interambulacralfelder
begrenzt. An den Seiten liegen die zerstreut stehenden Paare runder,
feiner Poren in kleinen Einsenkungen, bis sie bei Verflachung der
Furche vershwinden. Die vorderen paarigen Ambulacralfelder liegen in
tiefen, nach vorn scharf begrenzten, sehr schwach S-förmig
geschwungenen, mehr keulenförmigen Furchen. An den Seiten derselben
liegen 25 Paare schlitzförmiger Poren. Die Innenzone zwischen den
beiden Reihen eines Ambulacralfeldes erscheint schmal, glatt und
ausgehöhlt. Die vorderen paarigen Ambulacralfelder sind sehr kurz, die
tiefen Einsenkungen, in denen sie liegen, oval. Man zählt in jeder
Reihe 15-16 Porenpaare von der Form derer der vorderen paarigen
Ambulacren, aber viel gedrängter gestellt. Zwei Genitalöffnungen
lassen sich erkennen. Um die Ambulacralfelder hat zine ziemlich breite
Fasciole den gewöhnlichen Verlauf. Innerhalb derselben sind alle
Theile der Interambulacralfelder dicht mit Körnchen besetzt,
ausserhalb degagen nehmen dieselben an Grösse nach dem Rande zu, wo
sie ausserdem viel zerstreuter stehen. Hinter dem Ende der vorderen
Ambulacren zweigt sich eine viel schmälere Lateralsubanalfasciole ab,
die steil nach unten verläuft und so tief unter das Periproct reicht,
dass sie fast den unteren Rand berührt. Auf der Unterseite liegt das
deutlich gelippte Peristom nahe dem Rande. Das Plastrum, mit den
gewöhnlichen Körnchenreihen bedeckt, ist gerundet dreiseitig, von
schmalen Mundstrassen eingefasst. Das runde, ziemlich grosse Periproct
liegt auf der steilen Hinterseite nahe dem oberen Rande. |
|
Es ist diese Art, welche v. Schauroth und Laube mit Schizaster
Beloutschistanensis verwechselt haben. Allerdings stehen sich
Beide nahe, aber schon die vorn tiefe, breite, mit steilen Rändern
versehene Ambulacralfurche unterscheidet sie genügend. Dieselbe ist
bei Schizaster Beloutschistanensis d'Archiac viel schmäler und
seichter. Ferner sind die vorderen paarigen Ambulacren bei letzterer
mehr S-förmig gebogen, bei unserer Art mehr keulenförmig, und
endlich ist die Hiterseite bei ersterer höher als hier.
Ein Exemplar von Ciuppio, ein zweites von San Giovenni Ilarione und
ein drittes von Montecchia mit Porocidaris serrata (Meneguzzo's
ausführliche Etiquette lautet : Mte. Zugiello presso la casa Gambojin
o Vitivinario di Montecchia).
Pl. IX
(extrait)
|
|
|
|
| |
Schizaster
globulus Dames,1877 -
Lutétien, Italie, 41 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
globulus Dames,1877 -
Lutétien, Arzignano, Italie, 33 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster cf.
lucidus Laube,1868 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Laube |
|
Ein Beitrag zur
Kenntnis der Echinodermen des vicentinischen Tertiärgebietes, 1868, p.32 |
|
|
|
Schizaster
lucidus
Laube.
Tab. VI, Fig.
1.
Der Körper ist fast kreisförmig, wenig länger als breit, sehr hoch,
nach vorn in einen schönen gleichmässigen Bogen abfallend ; die Basis
ist flach, die unpaarige Stirnfurche ist schmal, tief eingeschnitten,
bis an den Mund verlängert, die vorderen paarigen Ambulacren sind
ziemlich lang, schwach, keulenförmig nach Aussen gekrümmt, sehr tief,
die hinteren sind bedeutend verkürzt, etwa ein halbmal so lang wie die
vorderen ; die Poren sind gross, liegen in tiefen Furchen, und die
Paare sind von einander durch breite Wulste getrennt. Der Scheitel
liegt excentrisch etwa unter der Mitte gegen hinten ; er zeigt fünf
deutliche Oviducalöffnungen, von denen die der unpaarigen Furche
opponierte die kleinste, die zwischen den vorderen und hinteren
Ambulacren gelegenen die grössten sind. Die Peripetal-Fasceiole legt
sich dicht an die Spitzen der Petalen an und steigt in der Stirnfurche
in einem zierlichen Bogen auf. Die Subanal-Fasciole verläuft ziemlich
hoch über dem Rande und steigt tief unter das Periproct hinunter. Der
Mund ist schmal, die Mundstrassen eng, im Anfange mit einzelnen
Tastporen besetzt. Die Platte ist eiförmig, mit regelmässigen Reihen
sich nach dem Munde hin vergrössernder Warzen. Die übrigen Theile der
Basis sind nicht dicht mit grossen umhoften Schachelwarzen bedeckt,
zwischen denen man eine feine Granulation wahrnimmt, welche die
vorhergehende einfasst, wodurch diese Partie der Schale ein äusserst
zierliches Aussehen erhält. Das Periproct liegt hoch über dem unteren
Rande und auf einer ausgehöhlten Interseite, und ist von einem
stumpfen Kiel überragt.
|
|
Die Art unterscheidet sich durch ihren kreisähnlichen Umbang,
die schmale tiefe Stirnfurche, das Verhältniss der Ambulacren und die
hohy Form wesentlich von allen bisher bekannt gewordenen Arten dieser
Gattung.
Ein Exemplar vom Schurfe Lione bei Zovencedo ; mehrere andere aus Val
Scaranto mit Ostrea Martinsii.
Länge 52 Millim., Breite 52 Millim., Höhe 33 Millim., Länge der
vorderen Petalen 20 Millim., Länge der hinteren 9 Millim.
Pl. VI
(extrait)
|
|
|
|
| |
Schizaster cf.
lucidus Laube,1868 -
Lutétien, Italie, 43 mm |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
melitensis Stefanini,1908 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Stefanini, 1908 |
|
Echinidi mioceni di
Malta essistenti nel museo di geologia di Firenze, p.479 |
|
|
|
18. Schizaster
melitensis n. sp.
(Tav. XVII, fig.
14).
Guscio di piccole dimensioni, alquanto tumido, leggermente sinuoso in
avanti, con apice subcentrale.
Zone ambulacrali petaloidee, ambulacro impari diverso dagli altri,
decorrente in un solco più profondo, che va molto attenuandosi e
restringendosi verso l'ambito, e costituito da linee porifere diritte,
a pori radi, posti dentro doccie escavate nelle pareti laterali del
solco. Petali pari escavati, con zone porifere larghe e zigopori
radetti. Gli ambulacri anteriori sono flessuosi, mediocremente
divergenti, attondati all'estremità, circa il doppio, in lunghezza,
dei posteriori, che sono piriformi.
Zone interambulacrali tumidette, presso l'apice rilevate in forma di
coste.
Apparato apicale tetrabasale etmolisiano, apparentemente con quattro
pori genitali.
Tubercoli con scrobicola rialzata in forma di zoccoletto ovale e
mamellone eccentrico : finissimi nella faccia superiore, più grandi e
più radi assai sui margini e sulla faccia inferiore. Fasciola
peripetala ampia, ben visibile, molto sinuosa, e strettamente accosta
agli ambulacri. Poco dietro ai petali anteriori se ne stacca une
fasciola latero-sottoanale quasi rettilinea. Le placche sono convesse
nella loro parte centrale e come ombilicate.
La specie descritta dal Lambert come S. angustistella dei piani
inferiori del miocene sardo si riconosce per i petali più stretti, il
solco anteriore non ristretto verso il margine, gli ambulacri
anteriori pari piuttosto piegati in avanti che flessuosi, meno
divergenti, ecc. La specie che egli interpetra come S. sardiniensis
Cott. ha, in confronto della figura-tipo, un guscio assai più depresso
: cio non puo essere dovuto a semplice variabilita individuale, avendo
constatato sopra oltre venti esemplari sardi une notevole costanza in
questo carattere ; ma
|
|
puo
dimendere da un accidentale schiacciamento subito dall'esemplare
figurato dal Lambert. Comunque anche da esso si differenzia la nostra
speie per i petali anteriori flessuosi e aperti un poco in fuori
all'estremità, pel solco più stretto, dilatato verso il mezzo, e
uniformemente ristretto verso l'apice e verso il margine, ecc.
L'esemplare unico che è tipo di questa specie si trovava insieme ad
altri di Malta, ma senza cartellino speciale di provenienza. La roccia
nella quale è fossilizzato - un calcare un poco terroso, piuttosto
tenero, giallastro - è del totto simile a quello che si trova aderente
a certi esemplari di S. Parkinsoni, provenienti da Malta e
quasi certamente dal Globigerina Limestone. La specie è
rappresentata anche nelle arenarie ser entinose dell'Emilia (miocene
medio).
Pl. XVII
(extrait)
|
|
|
|
| |
Schizaster
melitensis Stefanini,1908
- Middle Globigerina Limestone, Gozo, Malte, 38 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster montserratensis
Lambert,1899 |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Lambert, 1908 |
|
Description des échinides
fossiles de la province de Barcelone, p.42 |
|
|
|
SCHIZASTER
MONTSERRATENSIS Lambert.
Pl. III, fig. 4 à 7.
Syn. Schizaster
montserratensis Lambert in Almera : Bull. S. G d F., 3e,
Sér., t. XXVI, p. 703. 1899.
Grande espèce (long. 160 mill., larg. 58, haut. 45), presque
subglobuleuse ; face. supérieure très renflée, hémisphérique, ayant sa
plus grande hauteur entre le périprocte et l'apex, légèrement déclive
en avant ; sillon antérieur profond en dessus, bordé de crêtes
saillantes, très atténué à l'ambi tus et disparaissant tout à fait en
dessous ; carène postérieure obtuse, s'abaissant à son extrémité vers
le périprocte. Pace inférieure subconvexe; face postérieure
obliquement tronquée, large, mais mal circonscrite. Péristome à fleur
du test, bien développé, semilunaire, éloigné du bord. périprocte peu
élevé, ovale, au sommet d'un large aréa et aux deux tiers de la face
postérieure. Apex central à quatre pores génitaux, les antérieurs très
petits et la plaque criblée s'étendant en arrière.
Ambulacre impair, droit, étroit, profond ; ambulacres pairs très
inégaux, relativement étroits, excavés, les antérieurs flexueux, à
porcs placés sur les flancs des sillons, conjugués, sauf les derniers,
vers l'apex, et zones interporifères Les ambulacres postérieurs sont
courts, moins profondément excavés, et ont leurs zones interporifères
plus étroites. Aires interambulacraires composées de liantes plaques,
présentant sur les flancs des convexités qui occasionnent des séries
de deux à trois protubérances noduleuses ; prés de l'apex ces aires
forment des crêtes saillantes, étroites, qui surplombent l'appareil
apical. Le plastron, qui se termine par une saillie centrale en forme
de talon, est relativement court et large, couvert de tubercules
scrobiculés peu développés, mais en séries obliques régulières.
Tubercules un peu plus gros en avant du péristome, diminuant assez
vite de volume en dessus, où ils se serrent et forment dans chaque
interambulacre des séries obliques au voisinage du fasciole, péripétal.
Ce dernier, très irrégulier et fortement coudé, enserre en arrière de
prés les pétales et ne s'éloigne un peu des ambulacres antérieurs
pairs qu'au point où se détache le fasciole latéral ; il s'élargit
ensuite pour traverser ces ambulacres ; puis gagne, en se
rétrécissant, la crête qui borde le sillon antérieur, au milieu de sa
longueur, et borde cette crête avant de se couder pour franchir le
sillon. Le fasciole latéral très étroit, visible seulement sur les
individus bien conservés, longe horizontalement les flancs jusqu'aux
aires ambulacraires postérieures, puis s'infléchit pour passer
sensiblement au-dessous du périprocte. |
|
Cette belle espèce, dont j'ai plus de quinze individus sous les yeux,
depuis la taille de 3o millimètres jusqu'à celle de 62, ne varie pas
clans ses caractères, elle est malheureusement trop souvent déformée
en raison du peu d'épaisseur de son test.
On ne saurait confondre le S. montserratensis avec aucun de ses
congénères. Le S. africanus de Loriol, plus petit, est moins
suhglobuleux, plus acuminé et subrostré en arrière. Il en est de même
des grandes espèces miocènes comme S. eurynotus et S. Peroni.
S. lucidus Laube, du Vicentin, est plutôt hémisphérique, plus
large, moins renflé, et a son sillon antérieur plus étroit ; S.
princeps Bittner, de taille encore plus forte, est plus carré,
bien moins renflé, a son apex plus excentrique en arrière et ses
ambulacres postérieurs beaucoup plus longs. S. Gaudryi de
Loriol, de l'Éocène d'Égypte, a peut-être plus de rapports avec notre
espèce, mais il s'en distingue par sa forme plus déprimée, subrostrée
en arrière, ses ambulacres moins profonds, les postérieurs plus longs,
etc. Une autre. forme voisine de l'Éocène d'Égypte est le S.
Santa-Mariai Gauthier, mais ce dernier a une forme plus allongée,
plus déclive en avant, un sillon antérieur échancrant davantage
]'ambitus, des ambulacres pairs plus larges et moins inégaux, un
péristome plus excentrique en avant, un fasciole moins coudé en avant,
circonscrivant en arrière de moins près les pétales (t).
Localités. — Montserrat, surtout à La Calsine ; Bagès ; El
Serra.
Pl. III
(extrait)
|
|
|
|
| |
Schizaster montserratensis
Lambert,1899 -
Eocène, barcelone, Espagne, 46 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
ocalanus (Cooke,1942) |
|
|
|
|
|
Schizaster (Linthia) ocalanus
Cooke,
n. sp.
Plate 5, figures 18-22
Test subglobular, cordate, the anterior depression
extending from the apical system to the peristome, the upper surface
more inflated than the lower. Apical system nearly central, with two
large genital pores, one between the ends of each lateral pair of
petals, and the madreporite extending behind them. Anterior ambulacral
area moderately sunken; pores of each pair separated by a high
granule. Petals nearly straight, sunken; anterior pair diverging at an
angle of approximately 120°, the posterior at an angle of
approximately 60°, anterior pair about twice as long as posterior;
open at the distal ends; poriferous zones about as wide as
interporiferous zones; pores conjugate. Peripetalous fasciole concave
between the lateral petals, convex elsewhere. Peristome far forward,
subtrigonal to subpentagonal, strongly lipped posteriorly, weakly
lobate anterolaterally. Periproct about as large as the peristome,
elliptical, higher than wide, high up on the flattened, sloping
posterior end. Surface covered with small tubercles.
Length of holotype, 21 mm.; width, 21mm.; height, 16
mm. Length of a paratype from station 14539, 33mm.; width, 32 mm.;
height, 27 mm.
Occurrence.-Florida:
Pit of the Ocala Limerock Company near Kendrick (holotype, station
13429, T. H. Hubbell, collector); pit of Cummer Lumber Company near
Kendrick, 4.8 miles nort of Ocala (station 12754a, C. W. Cooke
and T. P. Kirby, collectors); old MacDonald quarry 1 mile
|
|
north of Istachatta (figured
paratype, station 11112, C, W. Cooke and Stuart Mossom, collectors);
Oakhurst Lime Company, 2 1/2 miles southeast of Ocala (station 11749,
C. W. Cooke and Stuart Mossom, collectors); spoil bank of drainage
canal on U. S. 19, 5 miles south of Salem, Taylor County (station
14539, C. W. Cooke and W. D. Havens, collectors); quarry 6 miles
southeast of Crystal River (station 14141, W. C. Mansfield and C. W.
Mumm, collectors; Florida Geol. Survey, Frank Westendick, collector).
Geologic horizon.-Late Eocene, Ocala limestone.
Type.-U. S. Nat. Mus. 498990.
Remarks.-Schizaster (Linthia) ocalanus is
more globular than most American Linthias, and its periproct is
visible from above. Moreover, it has two instead of four genital
pores.
Planche 5
(extrait)
|
|
|
|
|
Holotype, conservé
au Smithsonian National Museum of Natural History |
|
figuré in
Cooke, 1942, Cenoizoic
irregular echinoids of eastern united states, p.42 |
|
|
| Catalog Number: |
USNM MO 498990 |
| Collection Name: |
Echinodermata Echinoidea Type |
| Scientific Name (As Filed): |
Schizaster (Brachybrissus)
ocalanus Cooke |
| Type Status: |
Holotype |
| EZID: |
http://n2t.net/ark:/65665/313b565d5-29f1-4ae6-b384-31fb51782aed |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
ocalanus (Cooke,1942) -
Eocène supérieur, Ocala limestone, Cté de Marion, Floride, 19 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
parkinsoni (Defrance,1835) |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Desor |
|
Synopsis des échinides
fossiles, p.392 |
|
|
|
Parkinsoni Agass. Catal.
rais. p. 128.- Wright Foss. Echin. From Malta. Ann. and Magaz. Nat.
Hist. Vol. XV. p. 52. Tab. V. fig. 3. - Syn. Spatangus Parkinsoni
Defr. Dict. sc. nat. Tom. L. p. 96. - Spatangus lacunosus
Parkinson Org. Rem. III. Tab. III. fig. 12. - Schizaster Goldfussii
Agass. Catal. syst. p. 3. - Schizaster Raulini Agass. Catal.
rais. p. 128. - Grande
|
|
espèce fortement élargie en
avant. Sillon impair profond, comme dans le S. Scillae, mais
les pétales antérieurs sont beaucoup plus divergents et, ce qui mérite
surtout d'être signalé, le sommet ambulacraire est à peu près central,
au lieu d'être très excentrique. |
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Vautrin, 1933,
Les
échinides burdigaliens de la zone désertique syrienne, p.113 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
parkinsoni (Defrance,1835)
-
Burdigalien, Lybie, 41 mm |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
parkinsoni (Defrance,1835)
-
Upper Globigerina lmst, Gozo, Malte, 35 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
rimosus Desor,1847 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Desor |
|
Synopsis des échinides
fossiles, p.391 |
|
|
|
Rimosus
Desor Catal. rais. p. 128. - D'Arch. Foss. numm. Mém. Soc. géol. de
France, 2e Sér. Vol. III, p. 425, Tab. XI, fig. 5. - Espèce large,
renflée et très accuminée en arrière. Sommet ambulacraire très
excentrique. Sillon impair peu profond et droit. Pétales antérieurs de
moitié plus courts que le sillon impair, sensiblement divergents,
formant une ligne droite avec les pétales postérieurs.
T. 51 (Type de l'espèce).
|
|
Terrain nummulitique de Biarritz, Christian près Montfort, Laplante,
Nousse.
Coll. d'Archiac, Delbos.
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Cotteau |
|
Paléontologie
française, terrains Eocènes, tome I, page 335 |
|
|
|
N° 90. Schizaster
rimosus, Desor, 1847
Pl. 100 et
101.
T. 51. (Type de l'espèce.)
Espèce de taille assez grande, cordiforme, presque aussi large que
longue, arrondie et échancrée en avant, étroite et subacuminée en
arrière. Face supérieure renflée, déclive dans la région antérieure,
épaisse sur le bord, ayant sa plus grande hauteur au milieu de
l'espace compris entre le sommet et l'extrémité postérieure, munie,
dans l'aire interambulacraire impaire, d'une carène qui se prolonge en
se recourbant jusqu'au périprocte ; la plus grande largeur se trouve
un peu en avant du sommet ambulacraire. Face inférieure presque plane,
arrondie au pourtour, légèrement bombée sur l'aire interambulacraire
impaire, un peu déprimée autour du péristome. Face postérieure
tronquée, très acuminée, plus ou moins évidée au-dessous du
périprocte. Sommet ambulacraire subcentral, un peu rejeté en arrière.
Sillon antérieur long, étroit, fortement excavé, caréné sur les bords,
se rétrécissant un peu vers l'ambitus et se prolongeant, en
s'atténuant, jusqu'au péristome. Aire ambulacraire impaire plus ou
moins étroite, munie, de chaque côté, d'une rangée de petits pores
s'ouvrant à la base de l'excavation, écartés, séparés par un granule
saillant et disposés par paires obliques. De petites côtes granuleuses
et transverses s'intercalent entre chaque paire de pores et remontent
dans la paroi de l'excavation jusqu'au bord de l'aire ambulacraire.
Une seconde rangée de pores très petits paraît exister, dans certains
individus, très près de l'extrémité externe des plaques, mais elle est
à peine distincte et fait défaut dans la plupart de nos exemplaires ;
en tout cas elle disparaît bien avant d'arriver à l'ambitus. La série
externe descend plus bas et se prolonge à peu de distance du fasciole
; les derniers pores sont plus petits, et les paires plus espacées.
Dans notre exemplaire, la zone porifère externe comprend vingt-huit ou
vingt-neuf paires de pores. Le milieu de l'aire ambulacraire est garni
de granules serrés, très fins, mais cependant inégaux. Aires
ambulacraires paires étroites, excavée, inégales, les antérieures
beaucoup plus allongées que les autres, très flexueuses, un peu
rapprochées du sillon antérieur, tout en étant sensiblement
divergentes. Aires postérieures courtes, subflexueuses, peu écartées.
Zones porifères assez larges, placées en grande partie sur les parois
de l'excavation ambulacraire, formées de pores ovales, unis par un
sillon, disposés par paires transverses que sépare une petite côte
granuleuse, au nombre de trente et une environ dans les aires
ambulacraires antérieures d'un individu de taille moyenne, et de vingt
et une ou vingt-deux dans les aires ambulacraires postérieures de ce
même exemplaire. Aux approches du sommet, les pores deviennent très
petits, presque microscopiques. La différence entre les zones
porifères antérieures et postérieures, dans les aires ambulacraires
paires antérieures, est à peine sensible. Zone interporifère se
rétrécissant aux deux extrémités, vers le milieu à peu près de même
étendue que l'une des zones porifères. Tubercules fins, serrés,
homogènes sur toute la face supérieure, un peu plus gros vers les
bords du sillon antérieur, au sommet des aires interambulacraires et
surtout à la face inférieure. Aires interambulacraires saillantes et
comprimées autour du sommet. Péristome très excentrique en avant,
semi-circulaire, fortement labié, la lèvre bordée d'un petit bourrelet
très apparent. Périprocte longitudinal, acuminé à ses deux extrémités,
s'ouvrant sous la carène dorsale, au sommet d'une aréa évidée,
subtriangulaire et vaguement noduleuse. Appareil apical granuleux,
étroit, toujours comprimé, paraissant muni de quatre pores génitaux.
Fasciole péripétale sinueux suivant de près les aires ambulacraires,
s'élargissant à son extrémité, à peine anguleux en arrière, traversant
le sillon antérieur à une assez grande distance du bord. Fasciole
latéro-sous-anal se détachant du fasciole péripétal en arrière des
aires ambulacraires paires antérieures, à peu près au quart de leur
longueur, plus étroit, descendant obliquement et sans sinuosité sous
le périprocte.
Nous connaissons un grand nombre d'exemplaires de différents âges
appartenant au S. rimosus. Quelques-uns sont d'une admirable
conservation et nous ont permis d'étudier cette belle espèce dans tous
ses détails. Elle offre peu de variations : le sommet, légèrement
excentrique en arrière, se rapproche plus ou moins du centre ; la face
postérieure, toujours acuminée, est plus ou moins évidée au-dessous du
périprocte. Les aires ambulacraires paires postérieures varient dans
leur longueur ; dans certains exemplaires, elles comprennent vingt et
un ou vingt-deux pores et quelquefois vingt-cinq ou vingt-six. Chez
les individus jeunes, la forme paraît souvent plus allongée, la carène
dorsale plus saillante, plus acuminée et la face postérieure plus
évidée. Nous avons cru devoir retrancher de la synonymie le S.
rimosus, figuré par Schauroth ; il nous paraît différer
essentiellement de notre espèce par sa forme et surtout par la
|
|
longueur de
ses aires ambulacraires. Le Schizaster, que cet auteur a figuré
sous le nom de S. Newboldi (non d'Archiac), s'en rapproche bien
davantage. Les individus décrits et figurés par M. Dames, sous le nom
de rimosus, malgré l'excentricité plus prononcée de l'appareil
apical, malgré l'étroitesse singulière de leur sillon antérieur,
malgré leur face postérieure très profondément évidée, doivent se
rapprocher de cette espèce, et forment, si les figures sont exactes,
une variété très curieuse.
Hauteur, 33 millimètres ; diamètre antéro-postérieur 59 millimètres ;
diamètre transversal, 55 millimètres.
Individu de taille moins forte : hauteur, 27 millimètres ; diamètres
antéro-postérieur et diamètre transversal 45 millimètres.
Individu jeune : hauteur, 17 millimètres ; diamètre antéro-postérieur,
25 millimètres et demi ; diamètre transversal, 23 millimètres.
Rapports et différences.
- Le S. rimosus, bien qu'il se rencontre associé au S.
vicinalis et qu'il s'en rapproche par quelques-uns de ses
caractères, ne saurait lui être réuni. La nouvelle étude que nous
venons de faire des nombreux échantillons qui nous ont été communiqués
nous engage à maintenir les deux espèces : le S. rimosus
s'éloigne d'une manière positive et constante du S. vicinalis
par sa face supérieure plus épaisse en avant et moins fortement
déclive, par son sommet ambulacraire plus central, par son sillon
antérieur plus étroit, par ses aires ambulacraires paires postérieures
relativement un peu plus longues. Ces différences sont assurément
légères, mais elles se retrouvent chez les individus jeunes comme chez
les exemplaires les plus développés.
Localités. - Biarritz,
falaise du phare Saint-Martin (Basses-Pyrénées) ; coteau de Gayot,
Laplante, Montfort (Landes) ; Baigtz près Orthez (Basses-Pyrénées) ;
Vence (Var). Assez commun à Biarritz. Eocène supérieur.
Ce n'est pas sans quelque doute que nous réunissons au S. rimosus
les échantillons assez abondants qu'on rencontre dans les environs de
Montfort : leur taille est en général moins développée, leurs aires
ambulacraires moins profondes, leur sommet plus central ; la plupart
de ces exemplaires sont écrasés, déformés, et il est difficile de
reconnaître d'une manière positive leurs caractères spécifiques.
Collection Pellat, Ecole des mines de Paris ; coll. de la Sorbonne,
musée de Toulouse (Coll. Leymerie). Faculté des sciences de Nancy
(Coll. Delbos) ; Hébert, coll. Degrange-Touzin, Linder, comte de
Bouillé, Boreau, Gauthier, ma collection.
Localités autres que la France.
- Priabona, Granella, Val Rovina, Santa-Libera (Vicentin).
Explication des figures.
- Pl. 100, fig. 1, S. rimosus, de Biarritz, de la collection de
M. Pellat, vu de côté ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face
inférieure ; fig. 4, périprocte ; fig. 5, portion de l'aire
ambulacraire impaire grossie ; fig. 6, tubercules de la face
inférieure grossis. - Pl. 101, fig. 1, variété élargie, de la
collection de M. Degrange-Touzin, vue de côté ; fig. 2, face
supérieure ; fig. 3, portion de l'aire ambulacraire antérieure grossie
; fig. 4, variété allongée, de Biarritz, de ma collection, vue sur la
face supérieure ; fig. 5, individu jeune de Biarritz, de la collection
de M. Degrange-Touzin, vu de côté ; fig. 6, face supérieure ; fig. 7,
autre individu jeune, de Biarritz, de la collection de M. Pellat, vu
de côté ; fig. 8, face supérieure.
Pl. 100 et 101 (extrait)
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Furon, 1941,
Géologie du plateau iranien (Perse - Afghanistan - Bélouchistan),
p.360 |
|
|
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Cahuzac & Roman, 1984,
Une
faune d'échinodermes mal connue : celle de l'éocène supérieur tardif du
Sud-Aquitain, p.714 |
|
|
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée d'Histoire Naturelle de Toulouse |
|
figuré in
Leymerie, 1881,
Description géologique et paléontologique des Pyrénées de la
Haute-Garonne accompagné d'une carte topographique & géologique et d'un
Atlas, p.818 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
rimosus Desor,1847
-
Lutétien, Landes, 31 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
rousseli
Cotteau,1887 |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Cotteau, 1887 |
|
Paléontologie
française, terrains éocènes, tome 1, p.284 |
|
|
|
N° 73 - Schizaster
rousseli, Cotteau, 1887
Pl. 85, fig.
4-7 et
pl. 86.
|
|
 |
|
Espèce de taille assez forte, arrondie, rétrécie, fortement émarginée
en avant, étroite et acuminée en arrière. Face supérieure épaisse,
renflée, déclive dans la région antérieure, ayant sa plus grande
hauteur dans l'aire interambulacraire postérieure, qui est élevée,
saillante, sub-carénée et se recourbe en descendant vers le périprocte
. Face inférieure légèrement bombée, arrondie sur les bords, déprimée
en avant du péristome. Face postérieure acuminée, tronquée, un peu
évidée. Sommet ambulacraire subcentral. Sillon antérieur large, très
profond, anguleux et caréné sur les bords, plus étroit et un peu
resserré vers l'ambitus, s'atténuant en se rapprochant du péristome.
Aire ambulacraire impaire assez large, finement granuleuse, munie de
chaque côté d'une rangée de pores simples, très écartés, séparés par
un renflement granuliforme saillant, disposés par paires obliques
s'ouvrant dans de légères fossettes. Près de l'ambitus, les pores se
rapprochent et deviennent plus petits. Aires ambulacraires paires
profondément excavées, inégales, les antérieures très flexueuses, se
rapprochant du sillon antérieur, beaucoup plus longues que les aires
postérieures également flexueuses. Zones porifères bien développées,
composées de pores oblongs, égaux, disposés par paires transverses, au
nombre de trente ou trente et une dans les aires antérieures, de vingt
à vingt et une dans les aires postérieures. Aux approches du sommet,
les pores deviennent très petits, presque simples. Zone interporifère
étroite, apparente cependant et paraissant ouverte à l'extrémité.
Tubercules finement crénelés et perforés, petits, serrés, homogènes à
la face supérieure, augmentant de volume à la partie supérieure des
aires ambulacraires, sur les bords du sillon antérieur, et surtout à
la face inférieure. Aires interambulacraires très saillantes autour du
sommet. Péristome excentrique en avant, pourvu d'une lèvre très
prononcée. Périprocte longitudinal, acuminé en dessus et en dessous.
Appareil apical muni de quatre pores génitaux placés à peu près sur la
même ligne ; la plaque madréporiforme allongée, large à la base, se
prolongeant à travers l'appareil, sans dépasser cependant les deux
plaques ocellaires postérieures. Fasciole péripétale large, très
sinueuse. Fasciole latéro-sous-anale plus étroite, non flexueuse,
descendant obliquement sous le périprocte.
Cette espèce
varie dans sa taille et aussi dans la position de son appareil apical
qui est toujours subcentral, mais quelquefois un peu rejeté en
arrière.
Hauteur, 35
millimètres; diamètre antéro-postérieur; 40 millimètres ; diamètre
transversal, 37 millimètres. |
|
Individu de
grande taille : hauteur, 39 millimètres; diamètre antéro-postérieur,
51 millimètres ; diamètre transversal, 48 millimètres.
RAPPORTS ET
DIFFÉRENCES. - Cette espèce se rencontre associée au S. obesus,
que nous décrivons plus loin ; elle s'en rapproche par plusieurs
caractères, par sa taille, par son sillon antérieur profond et se
rétrécissant vers l'ambitus, par son aire ambulacraire impaire munie
de chaque côté d'une rangée de pores ambulacraires très écartés ;
peut-être devrait-elle lui être réunie; elle nous a paru cependant
s'en distinguer par sa forme plus allongée, plus renflée à la face
supérieure, plus acuminée au-dessus du périprocte, plus évidée dans la
région postérieure et non proéminente à la base. Par sa forme
générale, cette espèce rappelle le S. beloutchistanensis de
l'Inde, auquel nous avions cru devoir la réunir, dans nos Échinides
fossiles des Pyrénées. Les deux espèces, comparées de nouveau avec
soin, nous ont paru bien distinctes: le S. beloutchistanensis
sera toujours reconnaissable à sa forme plus allongée, plus étroite,
émarginée moins profondément à l'ambitus.
LOCALITES. —
Conques, Saint-Martin-le-Vieil, Montagne Noire, Pradelles en Val,
Montagne d'Alaric (Aude); Montegret (Ariège). Assez rare. Éocène
moyen.
Collection de
M. Hébert, Musée de Toulouse (coll. Leyrnerie), coll. Roussel, Toncas.
EXPLICATION
DES FIGURES. - Pl. 85, fig. 4, S. Rousseli, exemplaire de
grande taille, de la collection de M. Roussel, vu sur la face
supérieure ; fig. 5, appareil apical grossi; fig. 6, individu jeune,
de la collection de M. Toucas, vu de côté; fig. 7, face supérieure. —
Pl. 86, autre exemplaire, de la collection de M. Hébert, vu de côté ;
fig. 2, face supérieure; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, aire
ambulacraire impaire grossie, montrant la disposition des pores ; fig.
5, aire ambulacraire paire antérieure grossie; fig. 6, périprocte ;
fig. 7, fasciole latéro-sousanale vue sous le périprocte.
Pl. 85 et 86 (extrait)
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Cotteau, 1887,
Paléontologie française - Terrain Tertiaire - Echinides éocènes,
t. 1, p.294 |
|
|
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée des Sciences de Laval |
|
figuré in
Cotteau, 1887,
Paléontologie française. Terrain tertiaire, I: Échinides éocènes,
familles des Spatangidées, des Brissidées, des Échinoéidées et des
Cassidulidées (pars), p.284 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
rousseli
Cotteau,1887 - Yprésien
inférieur, Huesca, Espagne, 37 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
rousseli
Cotteau,1887 - Yprésien
inférieur, Aren, Huesca, Espagne, 41 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
rousseli
Cotteau,1887 - Eocène
inférieur, Huesca, Espagne, 42 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
saheliensis
Pomel,1887 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Pomel, 1887 |
|
Paléontologie ou
description des animaux fossiles de l'Algérie, Zoophites, 2e fasc.,
échinodermes, p. 72 |
|
|
|
SCHIZASTER
SAHELIENSIS
A Pl. XII, lig. 1 à 5.
Longueur,
0m078 ; largeur, 0m065; hauteur, 0m040.
—
0 047 —
0 042 —
0 022.
Grand oursin
subelliptique, échancré en avant, un peu atténué en arrière et y
formant un rostre très obtus, peu saillant au dessus de la troncature,
un peu oblique en dessous. Apex déprimé, excentrique en arrière, aux
3/5 de la longueur, à 2 pores génitaux avec madréporide peu prolongé
en arrière. Ambulacre impair à pores rapprochés par paires, les
extérieurs un peu plus gros, séparés par un très petit granule,
disposés en une seule rangée contiguë au pli des assules ambulacraires
qui se relèvent pour former la moitié inférieure de la paroi abrupte
du sillon ; celui-ci plus de deux fois plus large que les pétales,
bien creusé, manifestement contracté à l'avant, au passage du fasciole,
puis formant un canal plus étroit et presque superficiel qui s'étend
jusqu'à la bouche après avoir échancré la face antérieure.
Pétales
antérieurs peu flexueux, brièvement coudés près de leur origine, bien
creusés, divergeant entr'eux de 50° à 54° et dépassant très peu la
moitié du rayon; les postérieurs oblongs, presque moitié longs comme
les antérieurs, divergeant entr'eux de 45". Le fasciole péripétale
bien développé, anguleux, serrant de près les pétales, coupant le
sillon impair vers sa contraction, près de son extrémité.
Interambulacres antérieurs étroits, saillants, en côte anguleuse,
portant deux carènes peu saillantes, un peu noduleuses, assez
rapprochées, s'interrompant sur la partie du sommet déprimée ; la face
versant au sillon est beaucoup plus étroite et plus déclive
|
|
que celle
versant au pétale, et elle se prolonge en surplomb au delà de l'arête
pour former la paroi supérieure presque lisse du sillon.
Interambulacres latéraux tronqués au sommet en dedans d'une faible
gibbosité; le postérieur semblablement tronqué pour compléter la
dépression apiciale, puis relevé en carène saillante qui s'efface au
haut du rostre assez fortement arrondi. Péristome en croissant
réniforme, rapproché du bord dans une dépression formée par les
sillons assez marqués des pétales du trivium, portant une lèvre
étroitement calleuse et proéminente . Périprocte circulaire sous le
rostre et au-dessus d'une aréa déprimée, faiblement tuberculée,
presque pentagonale, le côté plus étroit au-dessus du talon et bordé
par le fasciole latérosous-anal; celui-ci bien marqué quoique étroit,
s'insère sur une ligne en relief, descendant en écharpe de l'angle
fasciolaire situé derrière le 1/3 inférieur des pétales antérieurs.
Plastron grand, presque plat, ovale lancéolé, un peu contracté en
avant, bien en relief par suite de la déclivité des avenues
ambulacraires, lisses, assez larges, qui le séparent des
interambulacres latéraux. Tubercules du dessous serrés, presque
semblables au plastron et sur les côtés et assez gros ; ceux du dessus
également très serrés, bien plus petits, homogènes. Radioles du
dessous grêles, terminés en large spatule et couchés en avant.
Terrain
sahélien : environs d'Oran ; Aïn-Ameria, près de Lourmel.
|
|
|
|
|
figurés, conservés
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figurés in
Lachkhem &
Roman 1995 -
Les échinoïdes irréguliers (néognathostomes et
spatangoïdes) du Messinien de Melilla (Maroc septentrional), p.257 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
saheliensis
Pomel,1887 - Pliocène,
Nabeul, Tunisie, 52 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
saheliensis
Pomel,1887 - Pliocène,
Mazarros, Huesca, Espane, 76 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
scillae
(Desmoulins) |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Desor |
|
Synopsis des échinides
fossiles, p.389 |
|
|
|
Scillae
Agass. et Desor Catal. rais. p. 127. - Syn. Spatangus Scillae
Des Moulins. Tabl. synon. p. 392. - Schizaster eurynotus Agass.
Catal. syst. p. 2. - E. Sism. Echin. foss. Nizza p. 30. Tab. II. fig.
2 et 3. - Wright Foss. Echin. of Malta Ann. and Magaz of Nat. Hist.
Vol. XV. p. 49. - Schizaster graecus Agass. Catal. syst. p. 3.
- Grande espèce déprimée et étalée en avant, élevée et accuminée en
arrière. Silon impair très large et profond, mais se rétrécissant un
peu en avant. Pétales antérieurs légèrement arqués en S. Deux pores
génitaux. Aire interambulacraire postérieure renflée en une carène
saillante qui se termine en un rostre au dessus du périprocte.
P. 86. P. 95. (Schizaster graecus).
Tertiaire moyen de Santa Manza (Corse), Perpignan.
Grès calcaire (myocène) de Malte, Morée.
Tertiaire de Palerme, d'Asti, Monte Pelegrino ?
Mus. Turin, Coll. Des Moulins, Michelin, Lord Ducie, Ecole des Mines
de Paris.
|
|
NOTA.
Cette espèce a été pendant longtemps confondue avec l'espèce vivante
de la Méditerranée, dont elle diffère cependant par plusieurs
caractères ; ainsi, notre espèce est moins haute en arrière, les
pétales postérieurs sont moins courts, les antérieurs plus divergents
et le sillon impair un peu moins profond. Comme l'a montré M. Cotteau,
c'est à M. Des Moulins que revient le mérite d'avoir le premier
distingué cette espèce sous le nom de Spatangus Scillae. Comme
ce nom a l'antériorité sur le Sch. eurynotus de M. Agassiz,
nous n'hésitons pas à lui donner la préférence. Le Schizaster
Scillae Agass. du "Catalogue raisonné" n'est, selon toute
apparence, qu'une espèce nominale. Dût-on cependant s'assurer qu'elle
est distincte, le nom de Scillae n'en devrait pas moins rester
à l'espèce du Myocène qui est celle que M. Des Moulins avait en vue.
La figure de Scilla n'est probablement pas correcte. C'est par erreur
que M. Sismonda cite cette espèce dans le terrain crétacé. Le
Schizaster graecus n'est, selon toute apparence, qu'une variété
déformée de notre espèce.
|
|
|
|
| |
Schizaster
scillae
(Desmoulins) -
Helvétien, Portugal, 56 mm |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
spado
Lambert,1902 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Lambert |
|
Synopsis des échinides
fossiles, 1902, p.46 |
|
|
|
SCHIZASTER
SPADO Lambert
Pl. IV, fig.
12, 13.
Espèce de moyenne taille (long. 39 mill. ; larg. 35 ; haut. 20),
un peu déformée dans l'unique individu que je possède, très voisine du
S. Leymeriei Cotteau, mais à ambulacres plus larges et plus
profonds. Le sillon antérieur, profondément excavé en dessus, est
aussi plus large que celui du S. Leymeriei et rappelle plutôt
par sa forme celui du S. vicinalis, mais ce sillon se termine
brusquement à l'ambitus en échancrant à peine le bord.
L'apex très large est en même temps très court, l'ambulacre impair
s'avançant très près des postérieurs ; la plaque perforée par les
hydrotrémes est très étendue et la génitale postérieure gauche est
seule perforée ; ce pore génital unique est d'ailleurs largement
ouvert. En admettant que cet individu représente un cas tératologique,
la forme générale de l'apex et le rapprochement des ambulacres n'en
indiquent pas moins que les organes génitaux étaient chez lui
normalement très réduits.
|
|
Localité. - Je dois à M. Cossmann ce Schizaster,
recueilli par M. Vidal à La Baells (Catalogne).
fig in texte 5
et Pl. IV (extrait)
|
|
|
|
|
holotype, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Lambert, 1902,
Description des échinides fossiles de la province de Barcelone, p.46 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
spado
Lambert,1902 -
Lutétien, Espagne, 42 mm |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster studeri
Agassiz,1836 |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Cotteau |
|
Paléontologie
française, Terrains tertiaires, tome I, p.344 |
|
|
|
N° 92. —
Schizaster Studeri (Agassiz), 1836.
Pl. 103, 104 et 105.
S. 6 (type de l'espèce).
Espèce de grande taille, allongée, émarginée et rétrécie en avant,
subacuminée en arrière. Face supérieure haute, renflée en forme de
toit, très élevée dans la région antérieure et dans l'aire
interambulacraire postérieure, brusquement déclive en avant et sur les
côtés, fortement carénée en arrière, ayant sa plus forte épaisseur sur
la carène dorsale et sa plus grande largeur au point correspondant au
sommet. Face inférieure arrondie sur les bords, déprimée en avant du
péristome, légèrement bombée dans l'aire interambulacraire impaire.
Face postérieure étroite, verticalement tronquée, évidée. Sommet
ambulacraire presque central, un peu rejeté en arrière. Sillon
antérieur étroit, allongé, très profond, muni, sur les bords, d'une
carène saillante et noduleuse, se rétrécissant encore vers l'ambitus
et se prolongeant, en s'atténuant jusqu'au péristome. Aire
ambulacraire impaire munie, de chaque côté, d'une rangée de petits
pores allongés, écartés, s'ouvrant à la base de l'excavation, séparés
par une granulation plus ou moins apparente, disposés par paires très
obliques et serrées, au nombre d'environ trente-trois dans
l'intervalle compris entre le sommet et le fasciole ; les derniers
pores sont plus petits, plus rapprochés et les paires s'espacent en
même temps que les plaques qui les supportent s'agrandissent. Des
côtes fines, granuleuses, transverses, un peu atténuées, s'intercalent
entre chaque paire de pores et remontent sur la paroi de l'excavation
jusqu'au bord supérieur des plaques. Le milieu de l'aire ambulacraire
est un peu creusé et granuleux. Aires ambulacraires paires étroites,
fortement excavées, acuminées et cependant ouvertes à leur extrémité,
inégales, les antérieures très flexueuses, divergentes, sensiblement
infléchies en dehors, beaucoup plus longues que les aires
postérieures, qui sont plus rapprochées et moins flexueuses. Zones
porifères assez larges, placées sur les parois de l'excavation
ambulacraire, formées de pores oblongs, virgulaires, unis par un
sillon, disposés par paires transverses que sépare une petite côte
granuleuse, au nombre de trente-cinq ou trente-six dans les aires
antérieures, de vingt-trois ou vingt-quatre dans les aires
postérieures. Aux approches du sommet, les pores des sept ou huit
dernières paires deviennent très petits, surtout dans la zone porifère
antérieure des aires ambulacraires paires antérieures. Zone
interporifère apparente, presque aussi large que l'une des zones
porifères Tubercules en général très fins, serrés, homogènes sur la
face supérieure, un peu plus gros vers le bord du sillon antérieur, au
sommet des aires interambulacraires et à la face inférieure qui est
très tuberculeuse. Aires interambulacraires saillantes, comprimées,
subnoduleuses autour du sommet. Péristome excentrique en avant,
relativement un peu éloigné du bord, semi-circulaire, fortement labié,
la lèvre munie d'un petit bourrelet. Les aires ambulacraires forment,
de chaque côté du péristome, une dépression allongée, subangaleuse,
beaucoup moins accentuée cependant que dans le S. ambulacrum.
Périprocte ovale, longitudinal, médiocrement développé, s'ouvrant au
sommet de la face postérieure, sous la carène dorsale. Appareil apical
très étroit, paraissant pourvu de quatre pores génitaux. Fasciole
péripétale sinueux, suivant de très près le contour des aires
ambulacraires, formant un angle très prononcé au sommet de l'aire
interambulacraire impaire et longeant de très près le sillon antérieur
avant de le traverser, toujours large à l'extrémité des aires
ambulacraires. Fasciole latéro-sous-anal plus étroit, non flexueux, se
détachant du fasciole péripétale en arrière des aires ambulacraires
antérieures paires, à peu près au tiers de leur longueur. Un de nos
exemplaires présente sur plusieurs points une agglomération de petits
radioles; ils sont allongés, grêles, cylindriques, aciculés, lisses en
apparence, mais certainement garnis de stries très fines et
longitudinales.
Nous rapportons à cette espèce trois exemplaires provenant de l'éocène
supérieur de Vaugelade près Vence ; leur forme est allongée, le sommet
ambulacraire excentrique en arrière, le sillon antérieur étroit et
resserré près de l'ambitus ; les aires ambulacraires antérieures sont
recourbées, très flexueuses, sensiblement plus grandes que les aires
postérieures, qui sont légèrement acuminées à leur extrémité ;
cependant ils diffèrent un peu du type par leur taille moins forte,
par leurs aires ambulacraires relativement moins longues, un peu plus
larges et moins recourbées.
Hauteur, 43 millimètres ; diamètre antéro-postérieur, 60 millimètres;
diamètre transversal, 55 millimètres.
Variété de Vaugelade ; hauteur, 31 millimètres, diamètre
antéro-postérieur, 42 millimètres ; diamètre transversal, 39
millimètres .
Rapports et différences.
— Cette espèce, qu'on rencontre à Biarritz, associée au S. rimosus,
s'en distingue d'une manière positive par sa taille plus forte, par sa
forme plus allongée, par sa face supérieure renflée en forme de toit,
|
|
plus épaisse,
plus haute, plus brusquement déclive en avant et sur les côtés, par
son sommet un peu plus excentrique en arrière, par son sillon
antérieur bordé d'une carène plus saillante et plus noduleuse, par ses
aires ambulacraires paires antérieures plus longues, plus acuminées et
sensiblement infléchies en dehors, par son péristome plus éloigné du
bord, par son fasciole péripétale plus sinueux, serrant de plus près
les aires ambulacraires, pénétrant plus avant dans l'aire
interambulacraire postérieure et longeant le sillon antérieur avant
d'y pénétrer.
Histoire. - Il nous
paraît avoir existé relativement à cette espèce une assez grande
confusion. Le type est le moule en plâtre S. 6, désigné sous le nom de
S. Studeri par Agassiz, dès 1860. Qu'est devenu l'original ?...
provenait-il du comté de Nice ?... avait-il été recueilli dans le
Vicentin ?... nous l'ignorons ; toujours est-il que ce moule en plâtre
est parfaitement caractérisé et ne saurait être confondu avec aucune
autre espèce. C'est à tort, suivant nous, que Desor, dans le
Synopsis des Échinides fossiles, a réuni au S. Studeri le
S. Djelfensis, du Caucase, qui semble une espèce particulière
et le S. subincurvatus, qui nous paraît devoir être rapporté de
préférence au S. vicinalis. L'échantillon figuré par Sismonda,
malgré sa taille un peu plus forte et ses aires ambulacraires paires
postérieures plus écartées, parait bien se rapporter au S. Studeri;
il en est de même de l'individu de taille beaucoup plus petite figurée
par Schauroth sous le nom de S. beloutchistanensis.
L'échantillon dont M. Dames donne la figure, pl. IX, fig. 3, s'éloigne
davantage du type d'Agassiz (S. 6) par son sillon antérieur si
régulier, par sa face postérieure si acuminée et son sommet
ambulacraire très excentrique en arrière. Nous pensons cependant que
cet exemplaire, malgré ces différences, peut être considéré comme une
variété du S. Studeri. Les échantillons que M. Degrange-Touzin
et le comte de Bouillé ont recueillis à Biarritz diffèrent un peu du
type par leur forme plus épaisse et plus renflée, par leur sommet
ambulacraire un peu moins excentrique en arrière, par leurs aires
ambulacraires postérieures un peu plus développées. Tous leurs autres
caractères les rapprochent tellement du type S. 6, que nous n'avons
pas hésité à les y réunir. Cette espèce atteignait de très grandes
dimensions et nous lui rapportons un fragment rencontré à Biarritz par
M. DegrangeTouzin, dont le diamètre antéro-postérieur mesure plus de
78 millimètres ; les aires ambulacraires paires antérieures, tout en
conservant leur forme flexueuse et arrondie, grandissent en
proportion.
Localités. - Phare
Saint-Martin près Biarritz (couches à Operculines), la Gourepe (couche
à Serpula spirulaea). (Basses-Pyrénées); Vaugelade près Vence
(Var); Nice (Alpes-Maritimes). Rare. Éocène supérieur.
Collection Hébert, Degrange-Touzin, Maurice Gourdon, comte de Bouillé.
Localités autres que la France.
— Logivo, Laverda, Senago, Montecchio, Monte Arziano près Avesa,
Priabona (Italie).
Explication des figures.
— Pl. 103, fig. 1, S. Studeri, de Biarritz, de la collection de
M. Degrange-Touzin, vu de côté ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3,
aire ambulacraire antérieure paire grossie ; fig. 4, aire ambulacraire
paire postérieure grossie. — Pl. 104, fig. 1, le même exemplaire vu
sur la face inférieure ; fig. 2, portion de l'aire ambulacraire
antérieure grossie; fig. 3, péristome grossi ; fig. 4, moule en plâtre
S. 6, type de l'espèce, vu de côté ; fig. 5, face supérieure. — Pl.
105, fig. 1, portion d'un exemplaire de grande taille du S. Studeri,
de Biarritz, avec radioles, de la collection de M. Degrange-Touzin, vu
sur la face supérieure ; fig. 2, radiole grossi; fig. 3, S. Studeri,
variété à aires ambulacraires paires plus courtes, de Vaugelade près
Vence, de la collection de M. Hébert, vu de côté ; fig. 4, face
supérieure ; fig. 3, face inférieure; fig. 6, aire ambulacraire paire
antérieure grossie.
Planches 103,
104 et 105 (extrait)
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Lambert, 1918,
Révision des échinides du Nummulitique de la Provence et des Alpes
françaises, p.39 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster studeri
Agassiz,1836 -
Eocène inférieur, Ypresien, Huesca, Espagne, 30 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster variabilis
(Slocom,1909) |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Slocom, 1909 |
|
New echinoids from the
Ripley group of Mississippi, p.12 |
|
|
|
Linthia variabilis sp.
nov. Plate III, Figs. I-II.
Test distinctly cordate, truncated posteriorly, ventral surface
depressed convex, dorsal surface elevated, forming a sharp ridge in
the posterior interambulacral area. Sides inflated and sloping to the
lateral and anterior margins; posterior truncation slightly concave
and the angle between the truncation and the base line varying from
77° to 90 . Ambulacral areas straight, petaloid, situated in
comparatively deep depressions of the dorsal surface. Antero-lateral
pair about one and one-half times the length of the postero-lateral
pair, poriferous zones of these four petals wide, pores elongated and
slitlike. Each pair of pores connected by a shallow groove and the
pore near the border of the petal the larger. Unpaired anterior
ambulacral area situated in a deep depression the continuance of which
forms a sulcus in the anterior margin. Poriferous zones of this area
narrow and situated far apart. Pores round and each pair separated by
a tubercle. Interambulacral areas broad and composed of large plates.
Surface of the test covered with minute perforated tubercles having
crenulated bosses. These tubercles increase in size as they approach
the peristome. Interspaces filled with small tubercles and microscopic
granulations. Both peripetalous and lateral fascioles are clearly
defined, peripetalous fasciole decidedly bent inward between the
antero-lateral and postero-lateral petals and somewhat less so between
the other petals. Apical system situated in the center or somewhat
anterior to the center of the dorsal surface; small, depressed, having
the four genital plates perforated and separated by five small radials.
Peristome transversely elliptical, situated near the anterior margin.
Labrum prominent. Periproct somewhat elongated vertically and situated
near the top of the posterior truncation.
The dimensions of a number of practically perfect specimens are as
follows:
This table shows that this species exhibits great individual variation
in a number of characters. Thus the proportion of length to width
varies from wider than long to longer than aide; the proportion of
height to length is variable; the height of the periproct varies in
proportion to the height of the test; the basal line and the posterior
truncation form an angle varying from 73° to 90° and the position of
the apical dise varies from central through subcentral to decidedly
anterior. The manner in which these variations are combined is so
diverse, however, that no well-marked divisions can be made. Taking
two extremes of |
|
form
such as B and L we find B longer than wide, test low, periproct low,
posterior angle 75°, apex anterior; in L the length and width are
about equal, test high, periproct high, posterior angle 85°, apex
central. This combination of characters would seem to be of specific
importance, but S is wider than long, test high, periproct low,
posterior angle 84°, apex anterior ; F longer than wide, test high,
periproct low, posterior angle 82°, apex anterior; X longer than wide,
test low, periproct low, angle 77°, apex central. Hence it is evident
that these variations are not constant but individual variations.
Owing to this tendency to variation, the specific name variabilis
has been adopted.
Only one other species of this genus, L. tumidulus, has
hitherto been described from the American Cretaceous and that species
is so unlike L. variabilis that a detailed comparison is
unnecessary.
Locality: This species is from the Ripley Group and is quite abundant
both on the bluffs at One Mile Run and near the southern •edge of the
village at Pontotoc, Mississippi. Two casts which evidently belong to
this species were also collected by the writer in the Owl Creek marls
in Tippah County, Mississippi.
Planche III (extrait)
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Cooke, 1953 |
|
American upper
cretaceous Echinoids, p.36 |
|
|
|
Linthia variabilis Slocom
Plate 14, figures 18-25
Linthia variabilis
Slooom, 1909, Field Mus. Nat. History, Geol. Ser., vol. 4, no. 1, p.
12, text fig. la-c; pl. 3, ftgs. 1-11.
Linthia variabilis
Slocom. Clark, 1915, U. S. Geol. Survey Mon. 54, p. 99, pl. 54,
ftgs. la-1.
Linthia variabilis
Slocom. Stephenson, 1927, U. S. Natl. Mus. Proc., vol. 72, no.
2706, p. 10, pl. 5, figs. 1-7.
Linthia variabilis
Slocom. Stephenson and Monroe, 1940, Mississippi Geol. Survey Bull.
40, p. 280, pl. 10, figs. 1-5.
Linthia variabilis
Slocom
Stephenson, 1941, Texas Univ. Bull. 4101, p. 68, pl. 8, figs. 1-5.
Linthia variabilis
Slocom. Sanchez Roig, 1949, Paleontologia Cubana I, p. 268.
Test, cordate, vertically truncated behind; vertical profile higbest
behind the apical system. Apical system behind the center, having only
four genital plates, ail perforated, the lateral plates in
contact; posterior ocular plates separated by the madreporite,
which extends beyond them. Anterior ambulacrum sunken, subpetaloid,
the pores small, round, pores of each pair within the peripetalous
fasciole separated by a small bead. Paired petals straight, deeply
sunken; pores oval or slightly elongated, conjugate; poriferous zones
wider than interporiferous zones; anterior petals about twice as
long as posterior pair, less widely spreading. Peri stome far
forward, sunken, strongly labiate behind. Periproct large, higher than
wide, at the top of the posterior truncation, scarcely visible Crom
above. Peripetalous fasciole deeply indented between the lateral
petals; lateral fascioles meeting below the peri proct. Basal part of
posterior ambulacra having a shagreened surface; remaivder of base
covered with large tubercles on scaly socles; tubercles on upper
surface much smaller and crowded.
Length of figured specimen
24.2 mm; width 24.4 mm; height 18.5 mm.
Occurrence.-Mississippi: One Mile Run, south edge o( Ponto
toc, on the Houston road (type, A. W. Slocom; U.S.G.S. 6470, 6852, L.
W. Stephenson; U.S.G.S. 11652, L. W. Stephenson and C. W. Cooke;
17206, L. W. Stephenson and W. H. Monroe). Southwest edge of Pontotoc
(U.S.G.S. 6853, L. W. Stephenson). One mile east of Pontotoc (U.S.G.S.
6855, L. W. Stephenson). Owl Creek, 2 miles northeast of Ripley
(U.S.G.S. 8309, E. N. Lowe). Wallerville, Union County (U.S.G.S. 9604,
L. W. Ste phenson and Bruce Wade). Route 15, |
|
sec. 16, T 6 S, R
3 E, Union County (U.S.G.S. 18077, W. H. Monroe). North Carolina:
West side of Hilton Park, Northeast Cape Fear River (U.S.G.S.
4143, L. W. Stephenson) .
Arkan888: High bluff
on Ouachlta River 1.5 miles above Arka delphia (U.S.G.S. 13541, L. W.
Stephenson and C. H. Dane). Texas: Six miles east of Castroville
(U.S.G.S. 16156, L. W.
Stephenson); Hill
south of Seguin-San Antonio highway 2.5 miles west of
McQueeney, Guadalupe County (U.S .G.S. 15523, L. W. Stephenson).
Geologic horizon.-Prairie Bluff chalk in Mississippi, Peedee
formation in North Carolina, Nacatoch sand in Arkansas, Cor sicana
mari in Texas; ail of late Senonian (Maestrichtian) age.
Types.-Chlcago Natural History Museum, type of L. 11ari
abilia. · Figured specimens: U.S.N.M. 76251 (Stephenson and Monroe,
1940); U.S.N. M. 76283, 76284 (Stephenson, 1941); U.S.N.M.
73448 (pl. 14, figs. 18-21); U.S.N.M. 108401 (pl. 14, figs.
22-25).
Planche III (extrait)
|
|
|
|
| |
Schizaster variabilis
(Slocom,1909) -
Maastrichtien, Prairie Bluff Fm, William White Borrow Pit, Pontoloc Cty,
Mississippi, U.S.A., 24,6 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster ventiensis
Lambert,1906 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Lambert,1906 |
|
Etude sur les
échinides de la molasse de Vence, p.45 |
|
|
|
SCHIZASTER
VENTIENSIS Lambert
Pl. VII, fig.
3-5.
Espèce de moyenne taille, mesurant 35 millim. de longueur sur 32 de
largeur et 20 millim. de hauteur sous la carène près du périprocte.
Face supérieure très tourmentée ; apex peu excentrique en arrière. Ce
Schizaster, très inéquipétale, avec ambulacres pairs très peu
divergents, les antérieurs fortement coudés, mais de médiocre
profondeur, est surtout caractérisé par son sillon très profond, assez
large, sans étranglement antérieur, canaliforme, à bords saillants un
peu surplombants. Les interambulacres en saillie sont légèrement
bossués et les antérieurs forment vers l'apex deux crêtes infléchies
séparant les pétales. L'apex large ne porte que deux pores génitaux.
Le sillon antérieur entame assez profondément l'ambitus et se prolonge
en s'atténuant jusqu'au péristome, qui est nettement excentrique en
avant. Le plastron est peu saillant ; la face postérieure est
verticalement tronquée et la carène qui la relie à l'apex est bien
apparente.
Cette espèce appartient évidemment au sous-genre Brisaster;
elle est même assez typique et moins éloignée du B. fragilis
Düben o Koren (Brisus) des mers du Nord que la plupart des
espèces miocéniques. Je ne peux guère la comparer qu'aux S.
Morgadesi Lambert de l'Helvétien de Barcelone, et au S.
Lovisatoi
|
|
Cotteau, de la Sardaigne ; mais
le premier, plus allongé, plus déclive en avant, a ses ambulacres
pairs un peu plus étroits, plus profonds et plus longs ; son sillon
antérieur se rétrécit vers l'ambitus. Le second est plus large, plus
aminci et rostré en arrière ; son apex est plus excentrique ; enfin
son sillon tend encore à se rétrécir en avant. Tous deux, d'ailleurs,
appartiennent encore au groupe du S. eurynotus, tandis que le
S. ventiensis rentrerait mieux dans le groupe du S. fragilis.
Planche VII (extrait)
|
|
|
|
|
SYNTYPE, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris |
|
figuré in
lAMBERT 1906,
Etude sur les échinides de la molasse de Vence |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster ventiensis
Lambert,1906 -
Miocène, Langhien inférieur, Iskaszentyorgy, Bakony Mts, Hongrie, 45 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
vicinalis Agassiz,1847 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Agassiz |
|
Catalogue raisonné des
espèces, des genres et des familles d'échinides, p.21 |
|
|
|
vicinalis Agass. - X 93.
- Schizaster eurynotus Agass. Cat. syst. p. 3. - Espèce voisine
du Sch. eurynotus, mais de plus petite taille. Il en diffère
par ses ambulacres qui ne sont pas arqués en dehors.
Terr. numm. de Biaritz. Tert. de Saint-Palais, près Royen. - Deshayes,
d'Orbigny.
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Cotteau |
|
Paléontologie
française, terrains éocènes, tome 1, p.328 |
|
|
|
N° 89. - Schizaster
vicinalis, Agassiz, 1847
Pl. 98 et
99.
X. 93 : 12.
Espèce de taille moyenne, cordiforme, presque aussi large que longue,
arrondie et échancrée en avant, subacuminée en arrière. Face
supérieure fortement déclive dans la région antérieure, amincie en
avant, très élevée en arrière, ayant sa plus grande épaisseur au
milieu de l'espace compris entre le commet et l'extrémité postérieure,
munie, dans l'aire interambulacraire impaire, d'une carène saillante
qui se prolonge en se recourbant jusqu'au périprocte. La plus grande
largeur se trouve un peu en avant du sommet ambulacraire. Face
inférieure arrondie sur les bords, légèrement bombée sur l'aire
interambulacraire impaire, à peine déprimée autour du péristome. Face
postérieure tronquée, évidée, un peu rentrante. Sommet ambulacraire
très excentrique en arrière. Sillon antérieur large, profond, évasé,
excavé, comprimé et caréné sur les bords, se rétrécissant vers
l'ambitus qu'il entame fortement, se prolongeant très atténué, mais
distinct, jusqu'au péristome. Aire ambulacraire impaire large,
finement granuleuse, munie, de chaque côté, de deux rangées de pores.
La première série, placée très près de l'extrémité externe des plaques
dans l'excavation, est souvent peu distincte. La seconde série s'ouvre
à la base de l'excavation : elle est formée de pores écartés, séparés
par un granule saillant, disposés par paires obliques. De petites
côtes granuleuses et transverses s'intercalent entre chaque paire de
pores et remontent dans la paroi de l'excavation jusqu'au bord de
l'aire ambulacraire. A quelque distance de l'ambitus, la rangée
externe de pores disparaît ; la série interne descend un peu plus bas
; mais, en se rapprochant de l'ambitus, les pores deviennent plus
petits, le granule s'atténue, les pores se touchent pour ainsi dire,
et les paires sont plus espacées ; les côtes saillantes disparaissent
également. Dans l'exemplaire que nous avons décrit, la zone porifère
interne comprend trente et un ou trente-deux paires de pores. Le
milieu de l'aire ambulacraire est garni de granules serrés et très
fins, mais cependant inégaux. Aires ambulacraires paires étroites,
excavées, les antérieures beaucoup plus allongées que les autres, très
flexueuses, rapprochées du sillon antérieur, les aires postérieures
courtes, flexueuses, peu écartées. Zones porifères bien développées,
occupant en grande partie les parois de l'excavation ambulacraire,
formée de pores ovales unis par un sillon, disposés par paires
transverses, au nombre de trente-quatre ou trente-cinq dans les aires
ambulacraires antérieures, de dix-neuf ou vingt dans les aires
postérieures. Aux approches du sommet, les pores deviennent très
petits, presque microscopiques ; la zone porifère des aires
ambulacraires antérieures, très resserrée sous l'excavation, est plus
étroite que l'autre, à quelque distance du sommet. Zone interporifère
apparente, un peu moins large que l'une des zones porifères.
Tubercules fins, serrés, homogènes sur presque toute la face
supérieure, un peu plus gros sur les bords du sillon antérieur, au
sommet des aires interambulacraires et surtout à la face inférieure.
Aires interambulacraires saillantes et comprimées autour du sommet.
Péristome excentrique en avant, semi-circulaire, fortement labié.
Périprocte longitudinal, acuminé à ses deux extrémités, s'ouvrant à la
base de la carène dorsale, au sommet d'une aréa un peu évidée,
subtriangulaire et noduleuse. Appareil apical étroit, toujours
comprimé, paraissant muni de deux pores génitaux seulement. Fasciole
péripétale très sinueux, suivant de près les aires ambulacraires,
s'élargissant à leur extrémité. Fasciole latéro-sous-anal se détachant
du fasciole péripétale en arrière des aires ambulacraires paires
antérieures, à peu près au tiers de leur longueur, plus étroit,
descendant obliquement sous le périprocte.
Cette espèce, dont nous avons sous les yeux un assez grand nombre
d'exemplaires, éprouve quelques variations dans sa forme générale,
dans la largeur de son sillon antérieur, dans sa face postérieure
toujours acuminée, mais munie d'une carène plus ou moins saillante.
Les pores de l'aire ambulacraire antérieure paraissant varier
également dans leur forme et leur disposition. La zone porifère
externe n'est pas toujours visible, et dans certains exemplaires elle
semble faire entièrement défaut. Quant à la zone interne, elle se
compose de pores que nous considérons comme ne formant qu'une seule
série, mais qui sont plus ou moins espacés et semblent quelquefois
constituer deux séries distinctes. Nous n'hésitons pas, comme l'a fait
M. Gauthier, à réunir à l'espèce qui nous occupe un exemplaire du Kef-Iroud
(Algérie), paraissant offrir, sur certains points de l'aire
ambulacraire impaire, plusieurs rangées de petits pores, mais que
l'ensemble de ses caractères ne permet pas de séparer du S.
vicinalis. A Biarritz, l'espèce se rencontre à tous les âges :
chez les individus jeunes, les caractères sont les mêmes, seulement la
face postérieure est peut-être plus sensiblement acuminée et plus
évidée au-dessous du périprocte.
Type de l'espèce : hauteur, 30 millimètres ; diamètre
antéro-postérieur, 43 millimètres ; diamètre transversal, 42
millimètres.
Individu de taille moyenne : hauteur, 23 millimètres ; diamètre
antéro-postérieur, 36 millimètres ; diamètre transversal, 34
millimètres.
|
|
Individu jeune : hauteur, 17 millimètres ; diamètre antéro-postérieur,
23 millimètres ; diamètre transversal, 22 millimètres.
Exemplaire d'Algérie : hauteur, 30 millimètres ; diamètre
antéro-postérieur, 50 millimètres ; diamètre transversal, 48
millimètres.
Rapports et différences.
- Cette espèce, anciennement connue, se distinguera toujours
facilement de ses congénères à son aspect cordiforme et dilaté, à son
sommet ambulacraire très excentrique en arrière, à son sillon
antérieur large, profond, entamant fortement l'ambitus, à sa face
supérieure rapidement déclive, à sa face postérieure saillante et
carénée, à ses aires ambulacraires paires postérieures plus courtes et
plus rapprochées. Par l'ensemble de ses caractères, le S. vicinalis
se rapproche du S. Scillae (S. Eurynotus), avec lequel
il avait été confondu dans l'origine ; il s'en distingue par sa taille
moins forte, sa forme moins allongée, plus dilatée, par sa face
postérieure moins acuminée et munie d'une carène moins saillante et
moins longue, par ses aires ambulacraires paires antérieures moins
larges et moins flexueuses, par ses aires ambulacraires paries
postérieures paraissant plus courtes. Le S. Scillae occupe un
niveau bien différent et appartient au terrain miocène.
Histoire. - C'est en
1867, dans le Catalogue raisonné des Echinides, qu'Agassiz a
donné le nom de S. vicinalis au moule X. 93, dont l'original,
appartenant à l'Ecole des mines de Paris, provient du terrain éocène
supérieur de Biarritz. Plus tard, d'Archiac, sous le nom de
vicinalis, a décrit et figuré une espèce toute différente,
recueillie dans l'Eocène moyen de Saint-Palais, et il ajoute que
probablement le S. vicinalis ne se rencontre pas à Biarritz. En
1863, nous avons fait cesser cette confusion, en rendant au type de
Biarritz le nom de vicinalis et en donnant à l'espèce de
Saint-Palais, figurée par d'Archiac, le nom de S. Archiaci.
Nous réunissons au S. vicinalis le S. subincurvatus,
Agassiz, modèle en plâtre R. 22, que Desor, dans le Synopsis des
Echinides fossiles, indique comme une variété du S. Studeri.
La forme dilatée de l'espèce, son sillon antérieur large, profond,
caréné sur les bords, ses aires ambulacraires flexueuses et
rapprochées de l'aire ambulacraire impaire, ses aires ambulacraires
paires postérieures courtes et peu écartées, son appareil apical
excentrique en arrière lui donnent, suivant nous, beaucoup plus de
ressemblance avec le S. vicinalis. Du reste cette opinion, dans
l'origine, était celle de Desor qui considérait, dans le Catalogue
raionné des Echinides, le S. subincurvatus comme une espèce
très voisine du S. vicinalis, peut-être même identique.
Localités. - Biarritz
(Chambre d'Amour, côte du Moulin, falaise du Phare Saint-Martin)
(Basses-Pyrénées) ; Kef-Iroud (département d'Alger). Assez commun à
Biarritz. Eocène supérieur.
Ecole des mines de Paris, Musée de Toulouse (coll. Leymerie) ; coll.
Pellat, Comte de Bouillé, Boreau, Degrange-Touzin, Granger, Gauthier,
ma collection.
Localités autres que la France.
- Burga di Bolca, Monti Berici, Laverdà, S. Florano, Senago, Avesa
près Vérone.
Explication des figures.
- Pl. 98, fig. 1, S. vicinalis, de Biarritz, de la collection
de l'Ecole de mines, vu de côté ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3,
face inférieure ; fig. 4, portion de la face supérieure grossie ; fig.
5, autre exemplaire de la collection de M. Degrange-Touzin, vu de côté
; fig. 6, face postérieure. - Pl. 99, fig. 1, S. vicinalis, de
Kef-Iroud (Algérie), de la collection de M. Gauthier, vu de côté ;
fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, aire
ambulacraire impaire grossie ; fig. 5, exemplaire de taille plus
petite, de la collection de M. Degrange-Touzin, vu de côté ; fig. 6,
face supérieure ; fig. 7, exemplaire de très petite taille, de ma
collection, vu de côté ; fig. 8, face supérieure.
Pl. 98 et 99 (extrait)
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Cotteau, Peron & Gauthier, 1885,
Echinides fossiles de l'Algérie - Terrains tertiaires - Etage Eocène,
fasc. 9, t. 3, p.56 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
vicinalis Agassiz,1847 -
Eocène inférieur, Italie, 44 mm |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Schizaster
vilanovae Cotteau,1889 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Cotteau, 1890 |
|
Echinides éocènes de la province d'Alicante, p.38 |
|
|
|
N° 27. - Schizaster
vilanovae, Cotteau, 1889
(Pl. IV. fig. 10-13).
Espèce de taille moyenne, un peu rétrécie et échancrée en avant,
dilatée vers le milieu, subacuminée en arrière. Face supérieure
fortement déclive dans la région antérieure, élevée en arrière, ayant
sa plus grande épaisseur au milieu de l'espace compris entre le sommet
et l'extrémité postérieure, munie, dans l'aire interambulacraire
impaire, d'une carène saillante qui se prolonge en se recourbant
jusqu'au périprocte. La plus grande largeur se trouve un peu en avant
du sommet ambulacraire. Face inférieure arrondie sur les bords,
légèrement bombée sur l'aire interambulacraire impaire. Face
postérieure haute, étroite, tronquée, évidée, un peu rentrante. Sommet
apical subcentral. légèrement excentrique en arrière. Sillon antérieur
large, profondément excavé, saillant sur les bords, se rétrécissant
vers l'ambitus qu'il entame fortement, disparaissant à la face
inférieure avant d'arriver au péristome. Aire ambulacraire impaire
finement granuleuse, formée de petits pores simples, séparés par un
léger renflement, disposés par paires obliques, serrées d'abord,
s'espaçant en se rapprochant de l'ambitus. Aires ambulacraires paires
pétaloïdes, flexueuses, fortement excavées, très inégales, les
antérieures assez larges, flexueuses, plus allongées que les autres,
les postérieures plus courtes, plus rapprochées et en forme de
feuille. Zones porifères bien développées, occupant en grande partie
ies parois de l'excavation, composées de pores inégaux, unis par un
sillon, disposés par paires transverses. Zone interporifère apparente,
un peu moins large que l'une des zones porifères. Aires
interambulacraires plus ou moins saillantes aux approches du sommet,
toujours étroites et resserrées. Tubercules fins, abondants, homogènes
sur presque toute la face supérieure, un peu plus gros sur les bords
du sillon antérieur, à la partie supérieure des aires
interambulacraires et surtout à la face inférieure. Péristome
excentrique en avant, semi-circulaire, rapproché du bord antérieur,
fortement labié. Périprocte longitudinal, acuminé à ses deux
extrémités, s'ouvrant au haut de la face postérieure, à la base de la
carène dorsale. Appareil apical paraissant muni de quatre pores
génitaux; la plaque madréporiforme, très étendue, traverse l'appareil.
Fasciole péripétale sinueux, suivant de très près les aires
ambulacraires. Fasciole latéro-sous-anal se détachant du fasciole
péripétale en arrière des aires ambulacraires paires antérieures, au
quart à peine de leur longueur, étroit et descendant obliquement sur
le périprocte.
Les exemplaires que nous rapportons à cette espèce, tout en présentant
des caractères communs, varient un peu, non seulement dans leur.
taille, mais dans la longueur de leurs aires ambulacraires paires, et
dans l'aspect que présentent, à la face supérieure, leurs aires
interambulacraires plus ou moins saillantes, plus ou moins comprimées
sur le bord du sillon antérieur et aux approches du sommet apical. |
|
Hauteur, 25mm ; diamètre antéro-postérieur, 37 mm; diamètre
transversal, 35mm.
Individu plus jeune : hauteur, 18mm ; diamètre antéro-postérieur, 26
mm; diamètre transversal, 25mm.
Rapports et différences.
- II ne nous a pas été possible de rapporter cette espèce à aucun des
nombreux Schizaster éocènes connus ; bien qu'elle ne présente
aucun caractère nettement tranché, il nous a paru nécessaire d'en
faire le type d'une espèce particulière. Voisine du S. vicinalis
par la largeur et la profondeur du sillon antérieur, par sa face
postérieure acuminée, par son aire interambulacraire impaire
saillante, carénée à la face supérieure, rapidement et obliquement
déclive en avant, elle en diffère par son appareil apical beaucoup
plus central, par son sillon antérieur moins large, par ses aires
ambulacraires postérieures un peu plus longues, par son fasciole
péripétale serrant de plus près les aires ambulacraires. Son appareil
apical subcentral et la longueur relative de ses aires ambulacraires
postérieures rapprochent le S. Vilanovae du S. rimosus;
cette dernière espèce s'en éloigne cependant par son sillon antérieur
plus étroit, par ses aires ambulacraires paires antérieures plus
flexueuses, moins larges, plus rapprochées de l'aire ambulacraire
impaire : ce sont deux types que nous considérons comme bien
distincts.
Localités. — Callosa,
Alfaz, Orcheta, près Alicante. Assez commun. Éocène. Collections
Vilanova , de Loriot, Muséum de Paris (coll. paléont.), Cotteau.
Sorbonne (Nicklès).
Explication des figures.
- Pl. lV, fig. 40, S. Vilanovae, de ma collection, vu de côté;
fig. 44, face supérieure; fig. 12, face inférieure; fig. 13,
exemplaire de taille plus petite, du Muséum de Paris, vu sur la face
supérieure.
Pl. IV (extrait)
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par lambert |
|
Sur quelques échinides
fossiles de Valence et l'Alicante, communiqués par M. le Pr. Darder Pericas,
1935, p.370 |
|
|
|
Schizaster vilanovae
Cotteau, des marnes à lépidocyclines de Villa-joyosa (Alicante) (num.293).
- Cette espèce a bien quatre pores génitaux à son apex et elle se
distingue du S. archiazi Cotteau par sa forme plus rétrécie en
arrière, son apex central et ses pétales pairs plus droits. Comme l'a
indiqué Cotteau, je ne crois pas que l'on puisse la confondre avec les
S. vicinalis et S. rimosus ; mais je pense aujourd'hui
que mon S. cantaber, du Nummulitique de Santander, devrait être
réuni au S. vilanovae. Quant à mon S. thieryi, de l'Auversien,
il en diffère par ses pétales postérieurs plus courts et son sillon
plus atténué à l'ambitus.
|
|
|
|
|
syntype, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Cotteau, 1890,
Echinides éocènes de la province d'Alicante, p.38 |
|
|
|
|
|
|
| |
Schizaster
vilanovae Cotteau,1889 -
Eocène, Alicante, Espagne, 32 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Genre
Diploporaster
Mortensen,
1950
A monograph on the
echinoidea, p.160.
Espèce type
Diploporaster barbatus
Mortensen,1950
A monograph on the
echinoidea, p.160.
(désignation originale)
Extension
stratigraphique (bibliographique,
non vérifiée) : Eocène - Actuel |
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Diploporaster savignyi
(Fourtau,1904) |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Fourtau, 1904
(espèce nominale et ses
variétés, mises ici en synonymie) |
|
Contribution a
l'étude des Echinides vivant dans le Golfe de Suez, p.436 |
|
|
|
Schizaster Savignyi,
R. Fourtau, 1903.
Pl.I, fig. 4-5.
 Je décris le plus grand exemplaire.
Je décris le plus grand exemplaire.
Forme ovale, oblongue, arrondie et fortement échancrée en avant très
légèrement rostrée en arrière, peu renflée comparativement aux  autres
espèces vivantes. Face supérieure déclive d'arrière en avant, le point
culminant se trouvant au premier tiers de la carène de
l'interambulacre impair, face inférieure légèrement convexe : pourtour
très arrondi. autres
espèces vivantes. Face supérieure déclive d'arrière en avant, le point
culminant se trouvant au premier tiers de la carène de
l'interambulacre impair, face inférieure légèrement convexe : pourtour
très arrondi.
Sommet ambulacraire excentrique, en arrière aux 64/100 de la longueur.
Appareil apical légèrement enfoncé avec quatre pores génitaux, les
postérieurs bien ouverts, les antérieurs plus petits: le corps
madréporiforme dépassant beaucoup les génitales et les ocellaires
postérieures s'appuie contre 1:1 carène de l'interambulacre impair.
Pores ocellaires très petits, moins bien visibles. Ambulacre impair
dans un profond sillon assez large, se rétrécissant près de l'ambitus
qu'il entame fortement : la dépression plus légère à la face
inférieure se continue jusqu'au péristome : les zones porifères
longues se composent de doubles rangées do pores semblables à celles
du S. canaliferus Lmk. Les parois latérales du sillon sont
excavées, le fond relativement plat et couvert d'une. fine granulation
forme un plan incliné assez rapide à partir de l'apex jusqu'au premier
quart de la longueur où le sillon atteint sa profondeur normale.
Ambulacres antérieurs pairs étroits, assez creusés, arrondis à leur
extrémité, pas très flexueux et peu divergents. Zones porifères
coin-posées de 33 paires de pores séparées les unes des antres par une
cloison bien saillante et d'apparence lisse : l'espace interzonaire
est notablement moins large que l'une des zones. Du côté de
l'ambulacre impair, la zone porifère de chacun de ces deux ambulacres
est cachée par un repli des aires interambulacraires antérieures.
Ambulacres postérieurs courts, un peu plus larges, également creusés,
peu divergents et très légèrement flexueux : zones porifères composées
de 17 paires de pores.
Aires interambulacraires relevées un peu avant leur sommet, puis
s'abaissant vers l'apex. Les quatre aires interambulacraires paires
sont ornées de nodosités assez saillantes et aimés. Les aires
antérieures sont carénées et se déversent vers les sillons du trivium.
L'aire interambulacraire impaire est pourvue d'une carène mousse assez
forte qui, à partir du premier tiers de la longueur, se recourbe vers
la face postérieure, sans toutefois surplomber le périprocte.
Péristome labié, ovale transverse, assez grand, largement ouvert et
très rapproché du bord antérieur.
 Périprocte pas très grand, ovale longitudinal, et plus acuminé en bas
qu'en haut, ouvert au tiers supérieur de la face postérieure qui est
légèrement déprimée en dessous.
Périprocte pas très grand, ovale longitudinal, et plus acuminé en bas
qu'en haut, ouvert au tiers supérieur de la face postérieure qui est
légèrement déprimée en dessous.
Tubercules (le la face supérieure très petits et très serrés, à la
face inférieure ils sont un peu plus grands et plus scrobiculés, les
intervalles sont lisses ; les abords du péristome sont assez dénudés ;
les avenues ambulacraires qui limitent le plastron Sont lisses et
étroites, en arrière elles n'arrivent pas à l'ambitus.
Fasciole péripétale large, serrant (le près les ambulacres, remontant
très haut le long (le l'ambulacre impair qu'il franchit près de
l'ambitus. Le fasciole latéro-sous-anal, bien plus étroit, embranche
aux deux tiers des ambulacres antérieurs pairs et passe sous le
périprocte en limitant la dépression de la face postérieure.
Cette espèce est évidemment très voisine du S. canaliferus Lmk
de la Méditerranée. Tous deux dérivent sans nul doute du même type et
les différences qui existent entre eux datent de la séparation du
golfe de Suez d'avec la Méditerranée, car, depuis cette époque, les
deux espèces ont dû évoluer suivant les conditions de leur milieu
ambiant.
Pour bien connaître les différences qui séparent ces deux espèces je
comparerai mon S. Savignyi type avec un spécimen du S.
canaliferus ayant 57 mill. de longueur, de, taille légèrement
supérieure par conséquent. Voici les différences que je constate :
S. canaliferus est plus renflé et plus large, ses ambulacres
antérieurs pairs sont plus longs et moins flexueux ; ses |
|
ambulacres
postérieurs plus courts et plus droits ; le sillon de son ambulacre
impair est moins profond et entame moins l'ambitus ; le péristome et
le périprocte, sont beaucoup plus grands; les tubercules de sa face
inférieure sont plus gros, plus serrés et plus scrobiculés. Enfin,
S. canaliferus n'a que deux pores génitaux.
S. gibberulus L. Agassiz se distinguerait de notre espèce par
son ambulacre impair moins creusé et n'entamant que légèrement
l'ambitus, sa plus glande hauteur, et, s'il faut en croire Pomel, par
l'absence de fasciole à la partie antérieure, son ambulacre impair à
zones non bigéminées et son apex subcentral. Mais si nous ne
considérons que la ligure 5 de Savigny, les véritables différences
consisteraient surtout dans la forme gibbeuse du S. gibberulus
qui  est
plus large et plus haut, son ambulacre impair moins creusé et entamant
moins le bord, ses ambulacres antérieurs pairs plus divergents et
moins flexueux, son appareil apical moins enfoncé et sa face
supérieure moins déclive. est
plus large et plus haut, son ambulacre impair moins creusé et entamant
moins le bord, ses ambulacres antérieurs pairs plus divergents et
moins flexueux, son appareil apical moins enfoncé et sa face
supérieure moins déclive.
S. Savignyi est assez abondant dans la baie de Suez et l'on
peut assez facilement trouver des tests biens conservés le long de la
plage d'Aïn Moussa.
Schizaster Savignyi,
var. major, R. Fourtau, 1903.
PI. 1, fig.
6-7.
Dans la baie
de Mirsa Thlemel, à près de cent kilomètres au sud de Suez, j'ai
recueilli quelques grands spécimens de Schizaster que je ne
puis séparer du S. Savignyi mais qui en diffèrent par quelques
caractères que je crois dus à une plus glande taille, ce qui m'a amené
à créer une variété major pour ces spécimens un peu différents.
Les dimensions sont les suivantes :
L'on voit déjà par cet exposé les grandes différences en hauteur de
ces exemplaires entre eux et avec les types normaux de la baie de
Suez. Les autres caractères qui les distinguent sont : leur face
postérieure oblique qui fait que la carène de l'interambulacre impair
semble surplomber le périprocte, cette même carène moins prononcée,
l'apex plus central et le périprocte proportionnellement plus ouvert.
C'est la deuxième espèce, dans laquelle je signale pour les grands
individus le changement de direction de la face postérieure dû à la
grande différence d'accroissement de l'interambulacre impair et du
plastron. Ce caractère n'avait pas toujours été bien mis en évidence
et, cependant, il doit être pris en considération par ceux qui
s'occupent d'espèces fossiles, car bien souvent on se trouve
précisément en présence de spatangides de tailles différentes qui'
présentent eux aussi cette particularité, et, pour peu qu'ils ne
soient pas du même gisement où que la série que l'on a sous les yeux
ne soit pas complète, on est fortement tenté de voir là un caractère
spécifique suffisant pour différencier des individus qui, en somme,
appartiennent à la même espèce.
Pl. I (extrait)
|
|
|
|
| |
Diploporaster
savignyi (Fourtau,1904)
- Pléistocène, 10km S. Hurghada, Egypte, 40 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Diploporaster
savignyi (Fourtau,1904)
- Pléistocène, Hurghada, Egypte, 45 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Genre
Gregoryaster
Lambert,
1907
Description des
échinides des terrains miocéniques de la Sardaigne, p.59.
Espèce type
Pericosmus coranguinum
Gregory,1892
The Maltese fossil
echinoids and their evidence of the correlation of the Maltese rocks, p.615
(désignation originale)
Extension
stratigraphique (bibliographique,
non vérifiée) : Maastrichtien -
Eocène |
|
|
|
|
|
diagnose originale du
genre par Lambert, 1907 |
|
Description des
échinides des terrains miocéniques de la Sardaigne, p.59.
|
|
|
|
Sous-genre
GREGORYASTER Lambert, 1907.
Wright a décrit en 1855 (Poss. Echin. of Malta, p. 40). sous le nom.
d' Hemiaster Grateloupi, une espèce qu'il confondait avec le
Schizaster Grateloupi Sismonda ; il l'a reportée en 1864 dans le
genre Brissopris, puis Grégory en 1891 a voulu en faire un
Pericosmus (P. coranguinum), bien que le type ait quatre
pores génitaux à l'apex et manque de fasciole marginal.
Cette intéressante espèce, dont j'ai sous les yeux plusieurs individus
sardes, a été figurée par M. Grégory (Maltese foss. Echinoidea, pl.
11, fig. 3, 4) ; elle est remarquable par sa taille, sa forme
arrondie, subglobuleuse,' à peine sinueuse en avant, et ses longs
pétales, étroits et assez profonds : les antérieurs un peu arqués sont
très divergents, les postérieurs, moins arqués en sens inverse des
premiers, sont au contraire peu divergents. L'ambulacre impair, logé
clans un sillon à peine différent de ceux des autres, est composé de
pores rapprochés, séparés par un granule et s'ouvrant clans des
plaques basses. Le périprocte est au sommet d'une face postérieure
relativement haute et verticalement tronquée. L'apex est pourvu de
quatre pores génitaux. Le fasciole péripétale étroit, mais bien
distinct, est très sinueux ; aucune trace de fasciole marginal,
latéral ou sous-anal.
Cette forme est très distincte de Pericosmus, dont elle n'a ni
la physionomie générale, ni l'ambulacre impair, ni l'apex, ni le
fasciole marginal, et l'idée de la placer dans ce genre, déjà
critiquée par Gauthier (Annuaire géol. univ., T. VIII, p. 811, 1893),
doit être complètement abandonnée. Cet échinide a plutôt l'aspect d'un
Linthia, mais il est dépourvu de fasciole latéral. L'absence de
fasciole sous-anal ne permet pas d'en faire un Brissorna et, comme
Wright l'avait parfaitement compris, l'espèce se trouve ainsi rejetée
dans la Tribu des Hemiastériens. Ce n'est cependant pas un
Opissaster, puisqu'elle n'a ni la forme schizastérique, ni ses
ambulacres pairs flexueux et excavés et qu'elle possède plus de deux
pores génitaux à l'apex. Proraster crétacé a bien le même
fasciole et le même nombre de pores génitaux, mais ses ambulacres, son
sillon, sa forme générale sont trop différents pour que l'on puisse
confondre avec lui l'espèce de Malte et de Sardaigne. Trachyaster,
qui est à peine un sous-genre (1'Hemiaster a pour type une
petite espèce très inéquipétale T. globosus), à pétales
ambulacraires courts, flexueux, très divergents et dont la physionomie
est bien distincte de celle (le 1'Hemiaster Grateloupi Wright.
Mais Cotteau a réuni aux Trachyaster de Pomel des formes
éocènes à ambulacres pairs longs, droits, peu inégaux (T. Heberti
Cotteau), dont on serait tenté de rapprocher notre espèce, si
l'ensemble de ses caractères et la forme de son ambulacre impair ne
l'éloignaient pas encore de ces Hemiaster éocènes. En tous cas
l'espèce de Malte et de Sardaigne n'est pas un vrai Trachyaster
et dans ces conditions le mieux m'a paru de la placer dans une section
particulière du genre Hemiaster, en créant pour elle le terme
Gregoryaster, ainsi caractérisé :
Brissidæ de forte taille, à test mince, subcirculaire, renflé en
dessus. avec sillon antérieur très atténué à l'ambitus. Ambulacres à
pétales longs, droits, tous dans des sillons assez profonds; l'impair,
plus étroit, est composé de pores non conjugués rapprochés ; les pairs
sont en avant légèrement et régulièrement arqués et les postérieurs
sont peu divergents. Apex à quatre pores génitaux. Tubercules
homogènes ; un seul fasciole péripétale.
Type : G. coranguinum Grégory (Pericosmus) du Miocène de
Malte. |
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Gregoryaster coranguinum
(Gregory,1891) |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Gregory, 1891 |
|
The maltese fossil
echinoidea, and their evidence on the correlation of the maltese rocks,
p.[615] |
|
|
|
Species 2. Pericosmus
coranguinum, n. sp. Plate
II. figs. 3 and 4a, b.
Synonymy‑
Hemiaster grateloupi, T. Wright (non Siam.), 1855, "Fons.
Echinod. Malta," Ann. Mag. Hat. Hist. (2), xv. pp. 189, 190.
Brissopsis grateloupi, T. Wright (non Sism.), 1864,
" Foss. Echinidœ Malta," Quart. loura. Geol. Soc., xx. p. 484.
Diagnosis.—Form—Species large, as wide as long, nearly
circular, anterior margin not indented by the anterior furrow, or very
slightly so. Sides tumid. Seen from the side, the posterior margin is
vertical, and from the summit of this the posterior inter-radius rises
very slightly to the highest point just behind the apical dise. From
this point the anterior slope is somewhat steep to the well-rounded
anterior margin. There are a couple of prominent areas in the lower
posterior margin, separated by a broad but shallow depression which
runs up to the anus.
Ambulacra : Paired petals long, deeply impressed, and subequal in
length. The anterior ambulacrum is shallow, and disappears at or is
continued only as a very slight depression below the fasciole. The
antero-lateral petals are strongly divergent ; at the lower ends they
curve forward slightly. The posterior pair are a little shorter than
the others, and curve back towards the ridge of the posterior
interradius.
Apical System central ; four genital pores ; ethmolysian ; the
posterior part of the madreporite greatly expanded.
Fascioles : The peripetalous is well marked, but the lateral
indistinct.
Anus oval ; high on the vertical posterior margin.
Mouth bilabiate ; very near to the anterior margin.
Dimensions‑
Type.—Brit. Mus., E. 3405.
Distribution.—Malta—Globigerina Limestone.
Remarks.—This species differs from P. affinis, Laube,
from the Leithakalk, in several characters ; in the Austrian' species
the length is greater than the width, the apical dise is more
posterior, and the posterior border overhangs the anus, instead of
being vertical. From P. callosus, Manz.,t from the Bologna
Schlier, and the Molassa serpentinosa of Montese and Africa, it
differs in the greater depth of the anterior furrow in P. callosus,
and in the lower elevation of the posterior margin. The species is in
some ways more allied to P. altus (Ag.), but the differences
between them have been already pointed out.
Planche II
(extrait)
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Lambert, 1907 |
|
Description des
échinides des terrains miocéniques de la Sardaigne, p.60.
|
|
|
|
Gregogyaster coranguinum
Grégory (Pericosmus), 1891
Ce que je viens de dire du sous-genre me dispense d'entrer dans des
détails au sujet (le cette espèce. Le type sarde mesure 59mm de
longueur, sur 63m ni de largeur et 311"1" de hauteur.
Le Schizaster Grateloupi Sismonda, qui n'est certainement ni un
Schizaster, ni un Pericosmus appartient très
probablement au sous-genre Gregoryaster, mais il paraît
différer de l'espèce de Malte et de Sardaigne par son ambulacre impair
un peu moins profond, ses ambulacres pairs plus droits, les
postérieurs plus courts et plus divergents.
Une autre espèce de l'Oligocène (le Bude, connue sous le nom de
Pericosmus Arpadis Pavay, malgré sa grande taille, diffère très
peu de la nôtre par son apex plus central et son ambitus étroit,
anguleux ; ce qui peut tenir à l'écrasement du type. Il est donc
possible qu'un nouvel examen de tous ces individus et des matériaux
plus complets pour les formes piémontaises et hongroises conduisent à
réunir toutes ces espèces sous le nom plus ancien proposé par Sismonda.
Il est même certain que si Grégory n'avait pas créé son Pericosmus
coranguinum je n'aurais pas osé, malgré la différence de gisement,
en faire une espèce distincte sur de si légères différences. Mais
l'espèce existant, comme un doute peut subsister sur son identité avec
les P. Arpadis et Schizaster Grateloupi, j'ai cru devoir
provisoirement conserver (sic)
l'espèce créée par l'auteur anglais.
Il serait possible que le Linthia Peolae Botto-Micca, du
Pliocène d'Alexandrie, soit encore un Gregoryaster, mais
l'espèce n'étant connue que. par mi fragment indéterminable, il n'y a
pas lieu quant à présent d'en faire état.
Tous les
individus du G. coranguinum recueillis par M. Lovisato ont été
trouvés dans les marnes de Cameseda (Ales), couches rapportées à
l'étage Stampien, c'est-à-dire plus anciennes que celles qui ont
fourni le type de l'espèce, mais de. même âge que le G. Grateloupi
du Piémont. |
|
|
|
|
holotype, conservé
au British Natural History Museum
|
|
publié sur : Smith, A.
B. & Kroh, A. (editor) 2011. The Echinoid
Directory. World Wide Web electronic publication.
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory [accessed
25/01/2021]: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Gregoryaster
coranguinum
(Gregory,1891) -
Lower Globigerina limestone, Gozo, Malte, 70 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Genre
Linthia
Desor,
1853
Notice sur les
échinides du terrain nummulitique des Alpes, p.278.
Espèce type
Linthia insignis
(Merian in
Desor, 1853)
ibid.
Extension
stratigraphique (bibliographique,
non vérifiée) : Crétacé
supérieur - Paléocène
Syn.
-
Lutetiaster
Lambert,
1920, p.27 ; espèce type : Spatangus subglobosus
Lamarck,1816, p.240
-
Victoriaster
Lambert,
1920, p.27 ; espèce type : Pericosmus gigas
Mc Coy,1882, p.15
|
|
|
|
|
|
diagnose originale du
genre par Desor |
|
Notice sur les
échinides du terrain nummulitique des Alpes, 1853, p.278.
|
|
|
|
Genre Linthia. Des. - Oursins de grande taille à sommet
ambulacraire central ou à peu près. Ambulacres pairs grands et
profonds. Ambulacre ipair logé dans un large et profond sillon. Un
fasciole péripétal entourant les ambulacres de près comme chez les
Brissus, plus un fasciole latéral qui part de l'ambulacre pair
postérieur pour se diriger en arrière sous l'anus comme chez les
Schizaster. Granulation tuberculeuse très-serrée. Diffère des
Schizaster et des Prenaster par ses ambulacres à peu près
égaux et son sommet central, et de tous les autres genres par la
disposition de ses fascioles. Ce genre comprend, outre les espèces
nouvelles que nous allons décrire, plusieurs autres aue l'on a rangées
jusqu'ici dans les Hemiaster. Dédié à M. A. Escher de la Linth.
1
Linthia insignis Mer. - Très-grande espèce subconique à
ambulacres larges et profonds - Localité : environs d'Iberg ; assez
fréquente. Musées de Zurich et d'Einsiedlen.
|
|
Linthia spatangoïdes Des. - Espèce voisin du L. subglobosa
(Hemiast. subglob.), mais un peu plus allongée, à sommet
légèrement excentrique en avant. - Localité : Strockweid près d'Iberg
; assez fréquent. Musée de Zurich.
1 Il
existe déjà un genre de Coléoptères portant le nom d'Escheria,
nom créé par M. Heer, pour l'un des types tertiaires d'Oeningen. |
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Linthia
insignis (Mérian in
Desor, 1853) |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Desor |
|
Description des échinides tertiaires de la Suisse, 2ème partie, p.101 |
|
|
|
Linthia insignis, Mérian
Pl. XV, fig.
1. Pl. XVI, fig. 1. Pl. XVII, fig. 1-2.
Forme largement ovale, un peu en cœur, ordinairement un peu plus
longue que large, arrondie et très échancrée en avant, rétrécie en
arrière. Face supérieure plus ou moins renflée, relevée parfois très
fortement au sommet ambulacraire, à partir duquel elle s'abaisse,
suivant une déclivité régulière et assez forte, jusqu'au bord
postérieur ; l'aire interambulacraire postérieure impaire est renflée
et parfois fortement carénée. Les aires interambulacraires paires sont
assez rapidement déclives vers le pourtour. Le sillon antérieur
commence au sommet ambulacraire ; il est d'abord à peine déclive, mais
il s'abaisse tout à coup très fortement, devient presque abrupt, en
s'approfondissant beaucoup, et échancre largement et profondément la
face antérieure ; ses bords sont renflés et forment comme un gros
bourrelet. Face postérieure tronquée et très obliquement rentrante.
Face inférieure fortement renflée sur le plastron. Pourtour arrondi,
mais peu renflé.
Sommet ambulacraire excentrique en avant ; il est situé à 0,40 à 0,42
de la longueur totale de l'oursin.
Ambulacres pairs très longs, relativement étroits, enfoncés, droits, à
peine un peu courbés à leur extrémité ; les antérieurs, qui atteignent
presque le pourtour, sont très divergents, seulement un peu infléchis
en avant, presque transverses ; les ambulacres postérieurs sont bien
plus rapprochés et un peu plus courts que les antérieurs. Les zones
porifères sont composées de nombreuses paires de pores arrondis, unis
par un sillon ; elles sont presque aussi larges que l'espace
interporifère. Ambulacre impair logé au fond du sillon antérieur et
composé de petits pores disposés dans chaque zone porifère en rangée
unique de paires écartées.
Péristome situé très près du bord, à l'extrémité du sillon antérieur ;
sa lèvre inférieure est très saillante.
Périprocte ovale, très élevé, situé au sommet d'une area très creusée.
Fasciole péripétale entourant exactement les ambulacres qu'il longe à
peu de distance, il forme un angle très profond dans les aires
interambulacraires postérieures paires comme aussi dans l'aire
impaire, et il traverse le sillon antérieur assez près du sommet. Le
fasciole latéral embranche près de l'extrémité des ambulacres
antérieurs pairs, je n'ai pu le suivre sur toute sa longueur, ni
préciser le point où il passe sous le périprocte.
Tubercules très petits, homogènes, pas plus gros en dedans du fasciole
qu'en dehors, un peu plus volumineux à la face inférieure.
Variations. Je n'ai pas eu un grand nombre d'exemplaires à ma
disposition et cependant j'ai pu observer des variations assez
sensibles dans les dimensions proportionnelles ; la hauteur relative
surtout est bien plus considérable dans certains individus que dans
d'autres. Les jeunes exemplaires présentent tous les caractères
généraux des adultes.
|
|
Rapports et différences.
Le Linthis insignis se distingue bien par sa très grande
taille, son sillon très profond et abrupt, ses grands ambulacres, sa
face postérieure très obliquement rentrante, son plastron renflé, sa
face supérieure très relevée au sommet ambulacraire, et son fasciole
péripétale serrant de près les ambulacres. M. Winkler a décrit sous le
nom de Linthia Blombergensis une grande espèce des couches
nummulitiques de Bavière qui est très voisin du L. insignis,
et, à en juger par la figure, il n'est même pas impossible qu'elle ne
doive lui être réunie ; je ne l'ai pas fait parce que le L.
Blombergensis paraît avoir des ambulacres un peu moins longs, un
sommet ambulacraire un peu plus excentrique en avant, et parce que son
fasciole semble entrer moins profondément dans les aires
interambulacraires. Peut-être la comparaison immédiate d'exemplaires
un peu nombreux montrerait-t-elle que ces différences n'ont pas la
valeur de caractères spécifiques.
Localités. Blangg,
Sauerbrunn, Gschwaend, Heikenfluhli, environs d'Yberg (canton de
Schwytz).
Eocène. Nummulitique. Parisien I.
Collections. Musée de
Zurich. Musée d'Einsiedeln. P. de Loriol.
Explication des figures.
Pl. XV. Fig.
1. Linthia insignis. Exemplaire de très grande taille, un peu
aplati accidentellement, mais n'ayant jamais été très renflé. Gschwänd.
Pl. XVI. Fig.
1, 1 a. Pl. XVII. Fig. 1, 1 a. Autre exemplaire très bien
conservé. Blangg
Pl. XVII. Fig.
2, 2 a. Exemplaire de petite taille de la même espèce, dont la
face postérieure n'est pas oblique. Blangg.
Ces figures sont de grandeur naturelle ; les originaux appartiennent
au Musée de Zurich.
Pl. XV, XVI et
XVII (extrait)
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Linthia
insignis (Mérian in
Desor, 1853) -
Ilerdien, Aude, 100 mm |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Linthia aragonensis (Cotteau, 1887) |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Cotteau, 1887 |
|
Echinides recueillis dans la province d'Aragon par Maurice Gourdon, p.23 |
|
|
|
N° 12. -
Linthia aragonensis, Cotteau, 1887
Voy. pour la descript. et fig. de cette espèce, Échin. nouv. ou peu
connus, 2e sér., VIe fasc., p. 95, pi. XI, fig.
3.
Parmi les nombreux Linthia que nous connaissons, cette espèce,
représentée jusqu'ici par un seul exemplaire, nous a paru nouvelle. Au
premier aspect, l'espèce se rapproche du L. Rousseli, de
l'Éocène moyen de l'Aude; elle en diffère non seulement par sa taille
plus petite, mais par son sillon antérieur moins profond et plus
évasé, surtout à la face supérieure, par ses aires ambulacraires
paires plus étroites, plus longues et moins fortement excavées. Le
L. aragonensis rappelle également certains individus de grande
|
|
taille du
L. subglobosa, du bassin parisien; mais chez cette dernière
espèce, le sillon antérieur est moins accusé, les aires ambulacraires
paires sont plus larges et beaucoup moins longues. Cette étendue très
grande des aires ambulacraires donne au L. aragonensis une
physionomie qui le distinguera toujours facilement des espèces
voisines, notamment du L. Heberti.
LOCALITÉ. -
Pobla de Roda (Aragon). Très commun. Éocène moyen.
Coll. Maurice
Gourdon.
|
|
|
|
| |
Linthia aragonensis (Cotteau, 1887) -
Yprésien inférieur, Arguis, Huesca, Espagne, 37 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Linthia aragonensis (Cotteau, 1887) -
Yprésien inférieur, Huesca, Espagne, 26 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Linthia
canaliculata (Cotteau, 1877) |
|
|
|
|
| |
Linthia
canaliculata (Cotteau, 1877) -
Thanétien inférieur, Haute-Garonne, 35 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Linthia
canaliculata (Cotteau, 1877) -
Thanétien inférieur, Haute-Garonne, 35 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Linthia
canaliculata (Cotteau, 1877) -
Thanétien inférieur, Haute-Garonne, 49 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Linthia
canaliculata (Cotteau, 1877) -
Thanétien inférieur, Haute-Garonne, 30 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Linthia heberti
(Cotteau,1863) |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Cotteau, 1863 |
|
Echinides fossiles des Pyrénées, p.124 |
|
|
|
77.
Periaster Heberti,
Cocteau, 1863. PI. IX, fig. 4.
Espèce de taille
moyenne, sub-circulaire , cordiforme, plus large que longue, fortement
échancrée en avant, tronquée presque verticalement en arrière; face
supérieure haute renflée, obliquement déclive en avant, marquée dans
la région postérieure d'une .carène saillante qui partage l'aire
inter-ambulacraire impaire et se prolonge jusqu'au périprocte ; face
inférieure presque plane , déprimée autour du péristome, légèrement
renflée en arrière. Sommet ambulacraire central. Sillon antérieur
large, profond, évasé, anguleux , s'étendant du sommet au péristome.
Ambulacres pairs plus profonds encore que le sillon antérieur, droits,
allongés, ouverts à leur extrémité , les postérieurs moins longs que
les autres ; zones porifères plus larges que l'intervalle qui les
sépare , formées de pores ovales , espacés, peu nombreux, mais
très-apparents. Aires in ter-ambulacraires saillantes et renflées aux
approches du sommet. Tubercules abondants, inégaux , très-petits et
serrés à la face supérieure, plus gros et plus espacés dans la région
infrà-marginale et sur les bords du sillon antérieur. Périprocte
ovale, s'ouvrant au sommet de la face postérieure. Fasciole péripétale
très-sinueux , suivant presque partout le contour des ambulacres ;
fasciole latéro-anal étroit, oblique, à peine sinueux.
Hauteur, 31
millimètres; diamètre transversal, 48 millimètres; diamètre
antéro-postérieur, 40 millimètres?...
Rapports et différences.
— Cette espèce rappelle le Per. Orbignyanus que nous avons
décrit plus haut; mais, si d'un côté elle s'en rapproche par son
ensemble cordiforme, son sommet presque central et la structure de ses
pores ambulacraires, elle s'en éloigne d'une manière positive par sou
|
|
sillon antérieur plus profond et plus
anguleux, par sa face supérieure plus saillante et plus renflée en
arrière, plus fortement déclive en avant, par ses ambulacres
postérieurs plus étroits et plus allongés.
Localité. —
Biarritz (rocher du Goulet). Très-rare. Éocène, groupe nummulitique ,
couche à Serp. spiralaea. — Collect. Pellat.
Explication des figures.
— PI. IX , fig. 4. P. Heberti. de la coll. de M. Pellat. vu sur
la face sup.
Pl. IX (extrait)
|
|
|
|
| |
Linthia heberti
(Cotteau,1863) -
Ypresien inferieur, Arguis, Huesca, Espagne, 29 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Linthia heberti
(Cotteau,1863) -
Ypresien inferieur, Arguis, Huesca, Espagne, 29 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Linthia hovelacquei
(Cotteau,1889) |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par Cotteau, 1889 |
|
Echinides recueillis dans la province d'Aragon (Espagne) par M. Maurice
Gourdon, p.23 |
|
|
|
N° 13. — Linthia Hovelacquei, Cotteau,.
1889.
Pl. II, fig. 11-14 .
Linthia n. sp.
Cotteau, Echin. éocènes d'Aragon, Assoc. franç. pour l'avanc..
des sciences, Congrès de Toulouse, p. 520, 1887.
Espèce de taille moyenne, un peu plus longue que large, arrondie et
émarginée en avant, légèrement rétrécie en arrière. Face supérieure
haute, renflée, assez régulièrement bombée, déclive en avant,
saillante en arrière où se trouve la plus grande épaisseur. Face
inférieure plane, renflée sur les bords, bombée dans l'aire
interambulacraire impaire. Face postérieure haute, large,
verticalement. tronquée. Sommet ambulacraire presque central. Sillon
antérieur droit, large, médiocrement excavé, s'atténuant et se
rétrécissant vers l'ambitus qu'il entame faiblement, presque nul aux
approches du péristome. Aire ambulacraire impaire finement granuleuse
au milieu. Zones porifères formées de pores petits, simples,
rapprochés les uns des autres, séparés par un léger renflement
granuliforme, disposés par paires obliques et espacées. Aires
ambulacraires paires peu excavées, subflexueuses, ouvertes à leur
extrémité, très inégales, les antérieures beaucoup plus longues que
les autres, divergentes, tendant cependant à se rapprocher de l'aire
ambulacraire impaire, les aires postérieures plus courtes, bien moins
écartées. Zones porifères assez larges, formées de pores étroits, les
externes moins larges et moins ouverts que les autres, disposés par
paires transverses, au nombre de vingt-sept ou vingt-huit. dans les
aires antérieures, au nombre de vingt-trois vingt-quatre dans les
aires postérieures. Sur chacune des zones porifères, les pores en se
rapprochant du sommet deviennent. très petits, presque
.microscopiques. Zone interporale paraissant lisse, moins large que
l'une des zones porifères. Les aires interambulacraires, un peu
resserrées aux approches du sommet, sont cependant moins saillantes
que dans certaines espèces. Tubercules petits, espacés, homogènes sur
presque toute la face supérieure, un peu plus gros sur le bord du
sillon antérieur et à la face inférieure. Péristome semicirculaire,
labié, très excentrique en avant. Périprocte longitudinal , s'ouvrant
au sommet de la face postérieure. Appareil apical muni de quatre pores
génitaux largement ouverts et Placés à peu près sur la même ligne ; la
plaque madréporiforme, étroite et très étendue, traverse l'appareil.
Fasciole péri pétale sinueux et assez large. fasciole latéro-sous-anal
un peu plus étroit et descendant plus directement sous le périprocte.
Hauteur , 30 millimètres ; diamètre antéro-postérieur, 38 millimètres
; diamètre transversal, 37 millimètres. |
|
Rapports et différences.
— Cette espèce présente un peu la physionomie des Schizaster,
dont elle se rapproche par ses aires ambulacraires flexueuses et
recourbées en avant ; cependant son appareil apical presque central,
ses aires ambulacraires paires et son sillon antérieur médiocrement
excavé, nous ont engagé a la placer parmi les Linthia. Voisine par sa
forme générale et sa taille du Linthia Cotteaui, elle s'en
distingue par sa forme plus épaisse et plus renflée, par son sommet
ambulacraire plus central, par son sillon antérieur moins excavé,
échancrant moins fortement, l'ambitus et moins apparent aux approches
du péristome. Notre espèce s'éloigne encore davantage du Linthia
Raulini, dont la forme est plus allongée, la face supérieure plus
renflée et moins déclive dans la région antérieure, le sommet apical
plus excentrique en avant, les aires ambulacraires plus profondément
excavées, plus longues, plus linéaires et plus divergentes en avant.
Le L. Raulini est par tous ces caractères un véritable type de
Linthia, tandis que les L. Cotteaui et Hovelacquei
ont déjà, une tendance à se rapprocher des Schizaster.
Localité. — Pobla de Roda (Aragon). Assez commun. Éocène moyen.
Coll. Maurice Gourdon, Cotteau.
Pl. II (extrait)
|
|
|
|
| |
Linthia hovelacquei (Cotteau,1889) -
Ypresien inferieur, Huesca, Espagne, 46 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Linthia
macphersoni Cotteau,1889 |
|
|
|
|
| |
Linthia
macphersoni Cotteau,1889,
Eocene, Alicante, Espagne, 17 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Linthia
macphersoni Cotteau,1889,
Eocene, Aspe, Alicante, Espagne, 40 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Linthia
vilanovae Cotteau,1889,
Eocene moyen, Alicante, Espagne, 30 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Linthia
vilanovae Cotteau,1889,
Eocene moyen, Aspe, Alicante, Espagne, 42 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Linthia
wilmingtonensis Clark,1915 |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Clark in Clark & Twitchell |
|
The
Mesozoic and Cenozoic Echinodermata of the United States, 1915, p. 152 |
|
|
|
Linthia wilmingtonensis
Clark, n. sp.
Plate LXX,
figures 3a-c.
Determinative characters. - Test large, cordiform, gibbous
above, nearly flat below, ambulacra wide, anterior in deep groove,
anterolateral with petals in long deep grooves, postero-lateral with
petals about one-half the length of the anterolateral and also deeply
sunken. Interambulacra wide, prominent, and covered with numerous
small tubercles. Peristome in prominent depression.
Dimensions. - Length 56 millimeters ; width 55 millimeters ;
height 34 millimeters.
Description. - This relatively large form has an elevated
bibbous upper surface and a nearly flat lower surface except for the
peristome depression. It is cordiform in marginal outline about as
wide as long and rounded laterally.
The ambulacra are wide, the single anterior ambulacrum being situated
in a deep groove, which deeply indents the margin. The anterolateral
paired ambulacra have long, broad sunken petals, while those of the
posterolateral pair are only about half as long.
The interambulacral plates are covered with small perforated tubercles.
The peripetalous and lateral fascioles can be readily traced.
|
|
The peristome is in a pronounced depressionje near the anterior margin.
The periproct is not shown on the type form.
Locality. - Wilmington, N. C.
Geological horizon. - Castle Hayne limestone, upper Eocene or
Oligocene.
Collection. - U. S. National Museum (166482).
Pl. LXX (extrait)
|
|
|
|
|
Holotype, conservé
au Smithsonian National Museum of Natural History |
|
figuré in
cLARK in
Clark & Twitchell, 1855, Mesozoic and
Cenozoic Echinodermata of the United States, p.152 |
|
|
| Catalog Number: |
USNM MO 166482 |
| Collection Name: |
Echinodermata Echinoidea Type |
| Scientific Name (As Filed): |
Echinocyamus vaughani Twitchell in
Clark & Twitchell |
| Type Status: |
Holotype |
| EZID: |
http://n2t.net/ark:/65665/3950ead6c-dad3-449e-a8c0-e0c835806948 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Linthia
wilmingtonensis Clark,1915
-
Priabonien - Bartonien, Castle Hayne fm, Pender Cty, Caroline du Nord,
52 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Genre
Opissaster
Pomel, 1883
Classification
méthodique et genera des Echinides vivants et fossiles, p.37
Espèce type
Opissaster polygonalis
Pomel,1881 par
désignation originale
Extension
stratigraphique (bibliographique,
non vérifiée) : Eocène
inférieur - Pliocène
Syn.
|
|
|
|
|
|
diagnose originale du
genre par Pomel |
|
Classification méthodique et genera des Echinides vivants et fossiles, p.37 |
|
|
|
Opissaster Pom. Ovoïde
cordiforme ; apex plus ou moins excentrique en arrière ; 2 pores
génitaux. Ambulacre antérieur simple dans un sillon abrupte moins
creux en avant, mais échancrant le pourtour. Pétales antérieurs
obliques en avant, flexueux près de l'apex, creux ; les postérieurs
bien plus petits. Péristome labié, médiocre, rapproché du bord ;
périprocte petit au haut d'une aréa postérieure. Fasciole péripétale
sinueux. Le type est O. polygonalis du miocène supérieur
d'Algérie ; c'est, en quelque sorte, un schizaster sans fasciole
latéro-anal et on devra y classer tous ceux qui en sont dépourvus et
divers prétendus Hemiaster comme Katkburgensis, H. Scillae,
H. Cotteaui qui ont le madréporide prolongé en arrière. C'est
aussi la place probable de O. amplus (Desor sub Hemiaster)
qui serait bien une espèce crétacée. (Quenst. Petr. deutch.). |
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Opissaster cotteaui
(Wright,1855) |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Wright |
|
On
fossil Echinoderms from the Island of Malta, p.[96] |
|
|
|
Hemiaster Cotteauii, Wright. Pl. VII. fig. 2
a–d.
Test
orbicular, globose, much inflated, declining anteriorly, elevated
posteriorly, the interambulacrum forming a prominent carina which
terminates in a tail-like process above the anus ; posterior border
obliquely truncated; ambulacral areas deeply sunk ; an antcal
ambulacrum forms the sulcus in the anterior border; antero-laterals
long, and inclined to 45°; posterolaterals one-half the length of the
anterior pair, inclined to 57°; apical dise ncarly central; peripetal
fasciole broad and undulating; anus high under the carinal process ;
tubercles larger on the sides and base than on the dorsal surface ;
mouth labiate near the anterior border.
Dimensions.—Antero-posterior diameter 1 19/20 inch,
transverse diameter la inch, height le, inch.
Description.—This Urchin has a globose form, and is much inflated at
the sides; the dorsal surface is convex, and declines much more
rapidly from the apical dise to the anterior border, than from the
dise to the posterior border. The ambulacral areas (2 a) are
all deeply sunk ; the single ambulacrum is the longest, and forms a
considerable antcal sulcus; the antero-lateral pair have a gentic
double curve ; they are 7/10 ths of an inch in length, and form an
angle of 45°. The number of pores (2 c) in the avenues is
twenty-two pairs in the inner, and twenty-four in the outer zone; the
postero-lateral pair are scarcely half the length of the anterior
pair; they incline at 57°; their number of pores is ten and twelve
pairs. The peripetal fasciole (2 d) closely embraces the
ambulacral star; a naked track proceeds from the base of the
antero-laterals to the mouth, indicating the course of the imperforate
portion of the ambulacral areas : the rapid declivity of the anterior
part of the test strongly contrasts with the inflated condition of the
sides and the elevation of the interambulacrum ; from the centre of
this area a ridge rises which is produced into a tail-like process,
and beneath, the posterior border is scooped out, and truncated
obliquely downwards and inwards. The anus is situated high up,
immediately beneath the caudal prolongation ; the base is convex, and
a partially naked space on cach side of the sternal portion of the
interambulacrum, indicates the track of the basal portions of the
posterior ambulacra. The tubercles of the upper surface (2 b)
are smaller and more closely set together than those on the sides and
base, where they are larger, vider apart, and more fully developed.
|
|
They are
perforated and uncrenulated, and surrounded by a circle of small
tubereles. H. Colteauii resembles Spatangus (Hemiaster)
acuminatus, Goldf., but it is more globose, and its posterior
half is neither so elevated, nor yet so wedge‑shaped as that species;
the single ambulacrum is largcr and vider, and the antero-lateral pair
are more dcveloped in the German than in the Maltese form ; thcy
resemble each other in the interambulacrum in both posscssing a
tail-like terminal process, and in having the posterior border
obliquely seooped out ; they are both, likewise, Miocene Urehins,
S. acuminatus being found in that terrain near Cassel and
Düsseldorf (Germany), and at Bordeaux and Blaye (France).
Affinities and differences.—The depth and length of the
ambulacral areas, with the great declivity of the anterior aide of
the test, and the post-discal carina, with its caudate-like process,
serve to distinguish this species from H. Scillae,.
Locality and stratigraphical position.—Collected from bed No.
4, the calcareous sandstone at Malta. We dedicate this species to our
fricnd M. Cottcau, the learned author of 'Études sur les Éehinides
Fossiles du département de l'Yonne,' who bas most generously aided us
in our studies, by contributing the types of many of his species to
our cabinet for comparative investigations.
planche VII
(extrait)
|
|
|
|
|
holotype, conservé
au British Natural History Museum
|
|
publié sur : Smith, A.
B. & Kroh, A. (editor) 2011. The Echinoid
Directory. World Wide Web electronic publication.
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/echinoid-directory [accessed
29/01/2021]: |
|
|
|
|
|
| |
Opissaster
cotteaui
(Wright,1855) - Middle
Globigerina Limestone, Ta Nikol, Gozo, Malte env.14 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Opissaster gregoirei
(cotteau,1887) |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Cotteau, 1877 |
|
Paléontologie française, terrains tertiaires, t.1, p.414 |
|
|
|
N° 106. —
Ditremaster Gregoirei, Cotteau, 1887.
Pl. 116.
Espèce de petite taille, allongée, ovale, un peu rétrécie et
subtronquée en avant. Face supérieure renflée, arrondie sur les bords,
ayant sa plus grande largeur au point qui correspond à l'appareil
apical et sa plus forte épaisseur en arrière du sommet, au milieu de
l'aire inter-ambulacraire postérieure qui est légèrement carénée et se
recourbe au-dessus du périprocte. Face inférieure régulièrement et
faiblement bombée. Sommet ambulacraire subcentral, un peu rejeté en
arrière. Sillon antérieur large, accentué, entamant l'ambitus, se
prolongeant en s'atténuant jusqu'au péristome. Aire ambulacraire
impaire très granuleuse, formée de petits pores simples, disposés par
paires serrées près du sommet, s'espaçant au fur et à mesure qu'elles
se rapprochent de l'ambitus. Aires ambulacraires paires excavées,
inégales, les antérieures longues, très flexueuses, les aires
postérieures très courtes, en formes de feuille, les unes et les
autres arrondies et fermées à leur extrémité. Zones porifères bien
développées, composées de pores étroits, très allongés, à peu près
égaux, unis par un sillon, disposés par paires transverses, que sépare
une petite bande granuleuse, au nombre de vingt-deux ou vingt-quatre
dans les aires antérieures, de quatorze ou quinze dans les aires
postérieures. Zone interporifère très étroite. Dans chaque zone
porifère, les pores deviennent très petits, presque microscopiques aux
approches du sommet. Aires interambulacraires saillantes et comprimées
près du sommet, notamment les aires antérieures. Tubercules inégaux,
fins et espacés sur une grande partie de la face supérieure, plus gros
sur le bord du sillon antérieur, autour du sommet, dans la région
inframarginale et sur le plastron interambulacraire, très espacés aux
environs du péristome et laissant presque lisses, à la face
inférieure, les plaques ambulacraires. Péristome excentrique en avant,
subpentagonal, légèrement labié à la base, anguleux à la partie
supérieure, marqué d'un faible bourrelet. Périprocte ovale, acuminé à
ses deux extrémités, placé au sommet d'une aréa couverte de petits
tubercules espacés. Appareil apical muni en arrière de deux pores
génitaux ronds, très ouverts, saillants sur les bords; les plaques
génitales antérieures en sont dépourvues ; la plaque madréporique très
étroite traverse l'appareil. Fasciole péripétale large, bien distinct,
arrondi en avant, sinueux sur les côtés.
Nous
rapportons à cette espèce un exemplaire de taille plus forte,
recueilli par M. Hébert ; il diffère du type que nous venons de
décrire par sa forme un peu moins allongée, par son sillon antérieur
moins évasé, par ses aires ambulacraires antérieures moins flexueuses
et moins divergentes ; l'aspect, la disposition des tubercules et du
fasciole sont les mêmes et ne permettent pas, quant à présent, d'en
faire une espèce particulière.
Hauteur, 12 millimètres ; diamètre antéro-postérieur, 16 millimètres;
diamètre transversal, 14 millimètres.
Exemplaire de taille plus forte : hauteur, 19 millimètres; diamètre
antéro-postérieur, 23 millimètres ; diamètre transversal, 22
millimètres.
Rapports et différences.
- Par sa forme allongée et légèrement hexagonale, cette petite espèce
rappelle le D. Corvazii (Hemiaster, Taramelli); elle
s'en distingue cependant, par sa forme moins hexagonale et moins
anguleuse, par son sillon antérieur plus large, par ses aires
ambulacraires paires plus flexueuses, par son péristome plus anguleux.
Notre espèce, par la largeur de son sillon antérieur, par la structure
de ses
|
|
aires ambulacraires paires,
offre également quelque ressemblance avec le D. elongatus (Hemiaster,
Duncan et Sladen), du terrain nummulitique du Sind (Inde) ; cette
dernière espèce sera toujours facilement reconnaissable à sa forme
plus allongée, plus régulièrement ovale, à ses aires ambulacraires
paires munies d'une zone interporifère plus large, à son fasciole plus
étroit, à son péristome moins anguleux. Le D. Gregoirei offre
aussi quelques rapports de forme et de taille avec les D.
Prestwichi et branderianus (Hemiaster, Forbes, de
l'argile de Londres). Malheureusement ces exemplaires assez mal
conservés, ne peuvent être, d'après les figures, que très
difficilement comparés aux nôtres. Le D. Prestwichi parait
beaucoup moins accentué à la face supérieure; ses aires ambulacraires
sont moins larges, moins excavées, moins flexueuses, beaucoup plus
ouvertes, son périprocte est plus petit. Quant au D. branderianus,
il est muni d'un sillon antérieur plus profond et plus nettement
circonscrit, son périprocte est moins développé, son péristome plus
rapproché du bord et moins anguleux en avant.
Localités. —Faure-Negre,
Saint-Jean-de-Vergues, Montegut (Ariège); le Frechet (Haute-Garonne).
Assez commun. Eocène moyen.
Collections Roussel, Grégoire, Hébert, ma collection.
Explication des figures.
- Pl. 116, fig. 1, D. Gregoirei, de la collection de M.
Roussel, vu de côté; fig. 2, face supérieure; fig. 3, face inférieure
; fig. 4, face antérieure; fig. 5, face postérieure; fig. 6, portion
de la face supérieure grossie; fig. 7, portion de la face inférieure
grossie ; fig. 8, autre exemplaire, de la collection de M. Hébert, vu
sur la face supérieure ; fig. 9, autre exemplaire, de la collection de
M. Roussel, vu sur la face supérieure.
planche 116
(extrait)
|
|
|
|
| |
Opissaster gregoirei
(cotteau,1887) -
Lutétien, tavertet, Barcelone, Espagne, 21 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Genre
Ova
Gray,
1825
An attempt to divide
the Echinida, or sea eggs, into natural families, p.431
Espèce type
Spatangus canaliferus
Lamarck,1816 par
décision ICZN, opinion 209
Extension
stratigraphique (bibliographique,
non vérifiée) : Eocène - Actuel
Syn.
|
|
|
|
|
|
diagnose originale du
genre par Gray,1825 |
|
An
attempt to divide the Echinida, or sea eggs, into natural families, p.431 |
|
|
|
Ova, Van Phel.
Brissoides, Klein.
Body ovate, deeply grooved in
front ; ambulacra five, impressed.
O. canaliferus. Spatangus,
Lam. Klein, t.27, f. A. |
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Ova canalifera
(Lamarck,1816) |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Lamarck,1816 |
|
Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, p.31 |
|
|
|
11. Spatangue
à gouttière. Spatangus canaliferus.
Sp.
cordato-oblongus, basi postica gibbus ; ambulacris quinis impressis
patulis : antico profundiore canaliformi.
Spatangus
. . . Leske ap. Klein, tab. 27. fig. A.
Rumph. mus.
tab. 14. f. 2.
Encycl. pl.
156, f. 3. Scilla, tab. 25. f. 2.
Mus. n.°
Habite
l'océan indien. Mon cabinet. Cette espèce est une de celles qui,
quoique très-différentes, ont été confondues en une seule, sous le nom
d'echinus lacunosus. |
|
|
|
| |
Ova canalifera
(Lamarck,1816) -
Pliocène, Almeria, Espagne, 41 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Genre
Periaster
d'Orbigny,
1853
Paléontologie
française, terrains crétacés, tome 6ème, échinoides irréguliers, p.269
Espèce type
Spatangus elatus
Desmoulins,1837 par
désignation subséquente de Lambert
(1918), p.8
Extension
stratigraphique (bibliographique,
non vérifiée) : Cénomanien
Syn.
-
Lutetiaster
Lambert,
1920, p.27 ; espèce type : Spatangus subglobosus
Lamarck,1816, p.240
-
Victoriaster
Lambert,
1920, p.27 ; espèce type : Pericosmus gigas
Mc Coy,1882, p.15
|
|
|
|
|
|
diagnose originale du
genre par d'Orbigny |
|
Paléontologie française, terrains crétacés, tome VI, p.269 |
|
|
|
Genre
Periaster, d'Orb., 1854.
Spatangus
(pars) auctorum ; Schyzaster (pars), Agassiz.
Caractères. Avec tous les caractères extérieurs d'appareil
général et ocellaire, de bouche, d'anus, d'ambulacres, de forme
générale des trois genres précédents. Celui-ci est caractérisé
principalement par son fasciole, qui, tout en étant péripétale, comme
dans le genre Hemiaster, offre de plus sur les côtés une
branche de plus qui se détache du fasciole péripétale, vis-à-vis de
l'ambulacre pair antérieur, et vient passer bien au-dessous de l'anus.
Le sillon antérieur est peu creusé, et ses pores ne sont pas surmontés
de côtes verticales. Tubercules épars, inégaux, espacés.
Rapports et différences. Par son fasciole péripétale entier,
pourvu d'une branche latérale qui vient passer sous l'anus, ce genre
se distingue nettement de tous les genres précédents. Il se rapproche
par ce même caractère du genre Schyzaster, mais en diffère par
son fasciole superficiel, et non dans un sillon, par ce fasciole
entourant de moins près les ambulacres ; par son sillon intérieur non
profondément creusé et non pourvu lattéralement de sillons
transverses, comme dans les Schyzaster ; par une forme non
oblique, et par des tubercules inégaux et non serrés en dessus.
|
|
Ce genre ainsi circonscrit appartient aux terrains crétacés et
tertiaires, et se trouve vivant dans les mers chaudes et froides.
Voici du reste les noms des espèces de ces derniers terrains que nous
rapportons.
1° Periaster fragilis, d'Orb., 1855. Brissus fragilis,
Dub. et Kor. Zool. Bidr., p. 280, pl. 10, fig. 47, 49. Schyzaster
fragilis, Agassiz, 1847, Cat. raisonné, p. 128. Vivant, des côtes
de Finmark, dans les grandes profondeurs. Découvert par M. Loven, de
Stockholm.
2° Periaster gibberulus, d'Orb., 1855. Savigny, Descript. de
l'Egypte zool., pl. 7, fig. 6. Schizaster gybberulus, Agassiz,
1847. Catalogue raisonné, p. 128. Vivante, de la mer Rouge. M.
Lefebvre.
3° Periaster Cubensis d'Orb., 1855. Schyzaster Cubensis,
Agass., 1847. Cat. raisonné, p. 128. Fossile de l'étage contemporain
de l'île de Cuba, rapporté par M. de la Sagra.
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Periaster
elatus (Desmoulins,1837) |
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par d'Orbigny |
|
Paléontologie française, terrains crétacés, tome VI, p.270 |
|
|
|
N° 2199.
Periaster elatus,
d'Orb., 1853.
Pl. 897.
Spatangus elatus, Des Moulins, 1837. Etudes sur les Ech., p.
406.
Hemiaster elatus, Desor, 1847. Catal. rais., p. 123.
Id., d'Orb., 1847. Prod., 2, p. 178, n° 637.
Dimensions. Longueur totale, 31 millimètres. Par rapport à la
longueur : largeur, 97 centièmes ; hauteur, 80 centièmes.
Coquille très-haute, un peu anguleuse, presque aussi large que
longue, non échancrée en avant, un peu acuminée en arrière, dont la
hauteur a les 80 centièmes de la longueur, et dont le grand diamètre
transversal est un peu en arrière de la moitié. Dessus
très-convexe, obtus en avant, et s'élevant beaucoup de suite en courbe
presque inclinée, jusqu'en avant du sommet où se trouve la partie la
plus haute, qui se continue horizontalement ensuite jusqu'à l'aréa
anale très-excavée et évidée. Les parties interambulacraires s'élèvent
comme autant de hautes collines entre les ambulacres. Le sommet est
excentrique en arrière. Le pourtour, presque anguleux, offre sa plus
grande convexité à la base. Dessous presque plat, seulement un
peu bombé à la région médiane postérieure et excavé autour de la
bouche. Sillon antérieur peu creusé et marqué seulement jusqu'à
la hauteur des ambulacres Bouche bilabiée, placée en avant des
deux tiers antérieurs. Anus ovale longitudinalement, placé au
sommet d'une aréa très-prononcée, entourée de saillies coniques.
Ambulacre impair plus étroit que les autres, formé de paires de
pores espacées. Chacune a deux pores rapprochés, obliques, avec un
fort tubercule au milieu. Ambulacres paires, profonds,
très-divergents, assez larges, un peu inégaux, les antérieurs ayant un
tiers de plus long, formés de zones plus larges que l'intervalle qui
les sépare, composé de pores allongés et conjugués transversalement.
Tubercules épars, éloignés les uns des autres, très-inégaux,
s'augmentant des régions postérieures aux antérieures, et des
supérieures aux inférieures. Fasciole arrondi en avant, sinueux
sur les côtés et en arrière. La branche latérale s'abaissant
brusquement pour passer sous l'anus.
|
|
Rapports et différences. Par sa forme élevée, cette espèce se
distingue bien nettement des autres. Elle a été décrite comme
Spatangus par M. Des Moulins. M. Desor l'a placée dans le genre
Hemiaster ; mais nous y avons découvert un fasciole latéral qui
empêche de la conserver dans ce genre, et nous la plaçons dans celui
des Periaster.
Localité. Nous l'avons recueillie, dans le 20e étage
cénomanien, à Rochefort, à Fouras, à Charras, à l'Ile Madame
(Charente-Inférieure), où elle est peu commune.
Explication des figures. Pl. 897, fig. 1, grandeur naturelle ;
fig. 2, coquille grossie, vue en dessus ; fig. 3, dessous ; fig. 4,
profil longitudinal ; fig. 5, profil transversal, du côté de la bouche
; fig. 6, le même, du côté de l'anus ; fig. 7, ambulacre grossi ; fig.
8, pores de l'ambulacre impair, grossis ; fig. 9, pores des ambulacres
pairs antérieurs, grossis. De notre collection.
Pl. 897 (extrait)
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
d'Orbigny, 1854,
Paléontologie française - Terrains crétacés - Echinodermes, t. 6,
p.270 |
|
|
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée Vert, Le Mans |
|
figuré in
Neraudeau & al.,
2003, Le contenu paléontologique - Les oursins cénomaniens de
l'Ouest de la France (Sarthe et Charentes). In : Morel N. (coord.)
Stratotype Cénomanien, p.223 |
|
|
|
|
|
|
| |
Periaster
elatus (Desmoulins,1837)
-
Cénomanien, Charente Maritime, 23 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Periaster
undulatus (Agassiz,1847) |
|
|
|
|
|
diagnose originale de
l'espèce par Agassiz, 1847 |
|
Catalogue raisonné des espèces, des genres et des faimilles d'échinides,
p.24 |
|
|
|
undulatus
Agass. - S 8. - Cat. syst. p. 2. - Espèce courte et large. Ambulacres
correspondants à des sillons assez profonds.
Cr. chlor. de l'Ile-d'Aix (embouch. Charente), Saint-Aignant
(Indre-et-Loire)
- D'Orbigny
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
d'Orbigny, 1854,
Paléontologie française - Terrains crétacés - Echinodermes, t. 6,
p.272 |
|
|
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
Neraudeau & al.,
1998,
Tuberculation in spatangoid fascioles : delineating plausible
homologies, p.329 |
|
|
|
|
|
|
| |
Periaster
undulatus (Agassiz,1847) -
Sénonien, Lérida, Espagne, 28 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| |
Periaster
verneuili (Desor,1847) |
|
|
|
|
|
|
|
description de
l'espèce par d'Orbigny |
|
Paléontologie française, terrains crétacés, tome VI, p.235 |
|
|
|
N° 2176.
Hemiaster Verneuili,
Desor., 1847.
Pl. 878.
Hemiaster Verneuili, Desor, 1847. Catal. rais., p. 174. Modèle
T-54.
Id., d'Orb., 1847. Prod., 2, p. 201 . étage 21, n° 225.
Dimensions. Longueur totale, 25 millimètres. Par rapport à la
longueur : largeur, 100 centièmes ; hauteur, 56 centièmes.
Coquille Un peu hexagone, aussi large que longue ; offrant en
avant trois angles et une échancrure au milieu, plus rétrécie en
arrière où elle est tronquée, dont la hauteur a les 56 centièmes de la
longueur, et dont le grand diamètre transversal se trouve un peu en
avant de la moitié. Dessus peu convexe, déprimé et obtus en
avant ; de là s'élevant insensiblement jusqu'en arrière du sommet, où
se trouve sa plus grande épaisseur ; la courbe de ce point s'arque
jusqu'à l'aréa anale, coupée obliquement. Le sommet est à peu près à
la moitié. Le pourtour, anguleux et assez obtus, se trouve à la base.
Dessous très-plat, creusé autour de la bouche, mais légèrement
renflé à la région médiane postérieure, où se remarque à l'extrémité
une légère saillie conique. Sillon antérieur très-large,
fortement creusé partout. Bouche transverse, bordée d lèvres,
placée en avant des deux tiers de la longueur. Anus ovale,
placé très-haut, près du sommet d'une aire anale lancéolée, ornée de
saillies tout autour. Ambulacres très-grands, peu inégaux,
assez creusés. L'ambulacre impair large ; ses zones étroites
sont formées de pores rapprochés, ronds, séparés par une forte saillie
tuberculeuse. Ambulacres pairs peu inégaux, les antérieurs sont
seulement un peu plus longs que les postérieurs, tous creusés en
sillons ; les zones, légèrement inégales, sont aussi larges que
l'intervalle qui les sépare. Les pores, en fente étroite, sont
rapprochés et conjugués. Les tubercules sont inégaux, petits et
épars partout en dessus, beaucoup plus gros et écartés en dessous. Le
fasciole cerne de loin les ambulacres en avant comme en
arrière, en représentant un triangle émoussé, arrondi en avant,
acuminé en arrière.
|
|
Rapports et différences. Cette espèce se distingue de toutes
les précédentes par ses ambulacres très-longs, peu inéfaux, par se
dépression et sa forme élargie.
Localité. Elle est spéciale à l'étage turonien et a été
recueillie à Sainte-Maure (Indre-et-Loire), et à Thaims
(Charente-Inférieure), par M. d'Archiac ; à Soulage (Aude) ; à Fumel
(Lot-et-Garonne) ; et à Châtellerault (Vienne) ; par nous. (Nous avons
eu entre les mains plus de 10 échantillons de cette espèce).
Explication des figures. Pl. 878, fig. 1, Grandeur naturelle ; fig. 2,
coquille grossie, vue en dessus ; fig. 3, dessous. fig. 4, profil
longitudinal, fig. 5, profil transversal, vu du côté de la bouche ;
fig. 6, le même, du côté de l'anus ; fig. 7, ambulacres grossis ; fig.
9, Pores de l'ambulacre impair plus grossis ; fig. 8, pores de
l'ambulacre pair antérieur, grossis. De notre collection.
Pl. 878 (extrait)
|
|
|
|
|
figuré, conservé
au Musée National d'Histoire Naturelle de Paris
|
|
figuré in
d'orgigny, 1854,
Paléontologie française - Terrains crétacés - Echinodermes, t. 6,
p.235 |
|
|
|
|
|
|
| |
Periaster
verneuili (Desor,1847)
-
Turonien, Tunisie, 32 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|







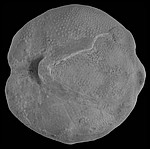





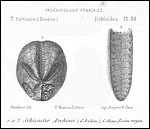





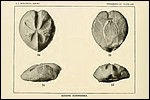




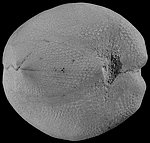







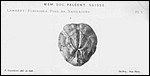








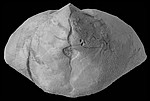




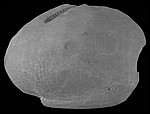
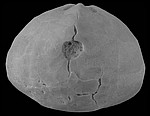


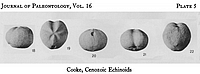





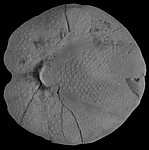

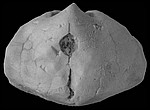
,%20apical,%20Upper%20Globigerina%20Lmst,%20Gozo,%20Malte,%2035%20mm.jpg)
,%20oral,%20Upper%20Globigerina%20Lmst,%20Gozo,%20Malte,%2035%20mm.jpg)
,%20ant,%20Upper%20Globigerina%20Lmst,%20Gozo,%20Malte,%2035%20mm.jpg)
,%20ambital,%20Upper%20Globigerina%20Lmst,%20Gozo,%20Malte,%2035%20mm.jpg)
,%20periprocte,%20Upper%20Globigerina%20Lmst,%20Gozo,%20Malte,%2035%20mm.jpg)










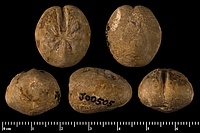










,%20apical,%20Pliocène,%20Nabeul,%20Tunisie,%2052%20mm.jpg)



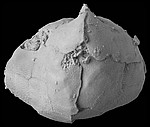
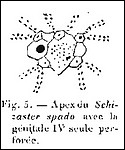



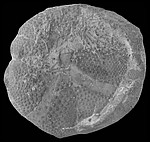
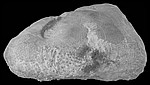

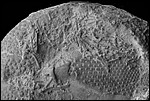




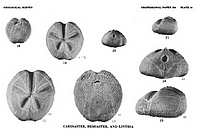
, periprocte, Maastrichtien, Prairie Bluff Fm, William White Borrow Pit, Pontotoc Cty, Mississippi, USA, 2.jpg)
,%20oral,%20Maastrichtien,%20Prairie%20Bluff%20Fm,%20William%20White%20Borrow%20Pit,%20Pontotoc%20Cty,%20Mississippi,%20USA,%2024,6%20mm.jpg)








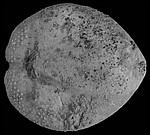





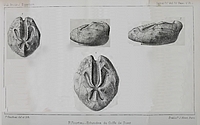
,%20ant,%20Pleistocene%20superieur,%2010km%20S%20de%20Hurghada,%20Egypte,%2040%20mm.jpg)
,%20periprocte,%20Pleistocene%20superieur,%2010km%20S%20de%20Hurghada,%20Egypte,%2040%20mm.jpg)
,%20oral,%20Pleistocene%20superieur,%2010km%20S%20de%20Hurghada,%20Egypte,%2040%20mm.jpg)
,%20ant,%20Pleistocene,%20Hurghada,%20Egypte,%2045%20mm.jpg)
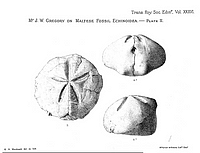




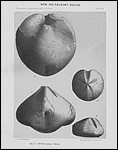


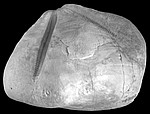




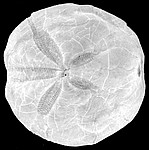
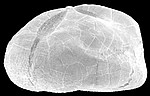
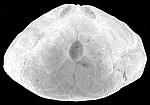
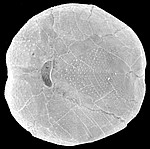



,%20apical,%20Ypresien%20inferieur,%20Arguis,%20Huesca,%20Espagne,%2029%20mm.jpg)
,%20periprocte,%20Ypresien%20inferieur,%20Arguis,%20Huesca,%20Espagne,%2029%20mm.jpg)
,%20oral,%20Ypresien%20inferieur,%20Huesca,%20Espagne,%2046%20mm.jpg)
,%20ant,%20Eocene%20moyen,%20Aspe,%20Alicante,%20Espagne,%2042%20mm.jpg)
,%20oral,%20Eocene%20moyen,%20Aspe,%20Alicante,%20Espagne,%2042%20mm.jpg)
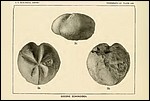


,%20planche%20VII.jpg)




,%20ant,%20Pliocene,%20Almeria,%20Espagne,%2041%20mm.jpg)
,%20oral,%20Pliocene,%20Almeria,%20Espagne,%2041%20mm.jpg)
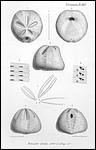





%20apical%20Senonien%20Lerida%20Espagne%2028%20mm.jpg)
%20ambital%20Senonien%20Lerida%20Espagne%2028%20mm.jpg)
%20periprocte%20Senonien%20Lerida%20Espagne%2028%20mm.jpg)
%20oral%20Senonien%20Lerida%20Espagne%2028%20mm.jpg)


