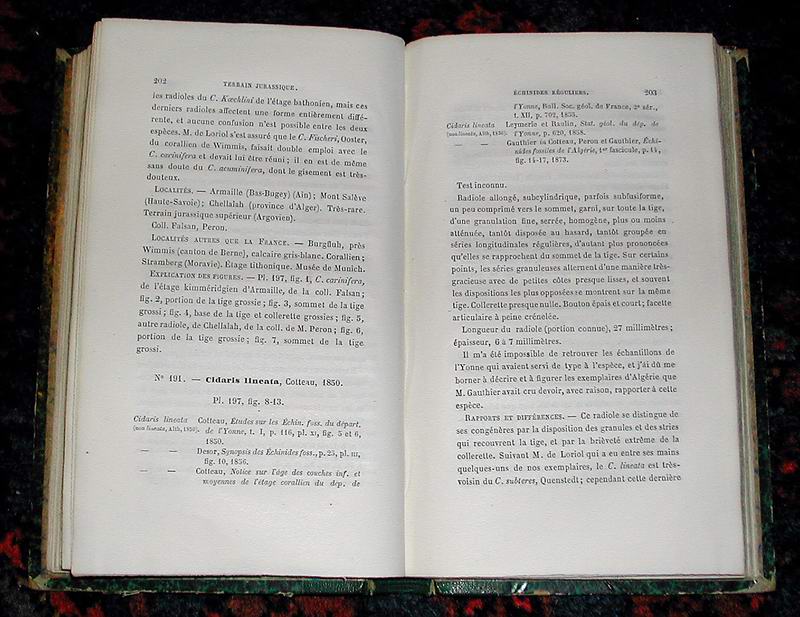Gustave Cotteau
in G. COTTEAU (1875-1880) Paléontologie française, Terrain Jurassique, Echinides réguliers
pages 351-357
N° 236. — Acrosalenia spinosa, Agassiz, 1840.
PI. 238 et PI. 239, fig. 1-3.
| Acrosalenia spinosa, |
Agassiz, Catal, syst. Ectyp. foss. Musei Neocomensis, p. 9, 1840. |
| Acrosalenia laevis, |
Agassiz, ibid., 1840. |
| Acrosalenia spinosa, |
Agassiz, Échinod. foss. de la Suisse, t. II, p. 39, pi. xviii, fig. 1-3, 1840. |
| — — |
Agassiz et Desor, Catal. rais. des Echinides, p. 39, 1847. |
| Acrosalenia laevis, |
Bronn, Index palaeont., t.I, p.9, 1848. |
| Acrosalenia spinosa, |
Bronn, ibid., 1848. |
| — — | Cotteau, Études sur les Échin. foss. de l'Yonne, t. I, p. 58, pl. III, fîg. 6-11, 1849. |
| — — |
D'Orbigny, Prodr. de paléont. strat,, t.I, p. 320, 11e et., n° 417, 1850. |
| — — |
Wright, Cidaridae of the Oolites, Ann. and Magaz. of Nat. History, 2e sér., t. VIII, p. 265, pl. XII, fig. 3, 1851. |
| — — |
Bronn, Lethaea geognostica, 3e édit., t. II, p.144, pl. XVII, fig. 7, 1851. |
| Acrosalenia radiata, |
Forbes, Memoirs Geol. Swvey, Echinodermata, déc. IV, pl. III, expl., p. 4, 1852. |
| Salenia spinosa, |
Quenstedt, Handbuch der Petrefakt., 1re édit., p. 576, pl. xlix, fig. 5, 1854. |
| Salenia spinosa, |
M'Coy, Contribution to Brit. Palaeontol., p. 67, 1854. |
| Acrosalenia spinosa, |
Forbes in Morris, Catal. of Brit. Foss.,2e éd., p. 70, 1854. |
| — — | Terquem, Paléont. de la Moselle, p. 32, 1855. |
| — — | Wright, On the Palaeont. and Stratigr. Relat. sands of the inf. Ool., Quarterly Journal of the Geol. Soc., p. 320, 1856. |
| — — |
Desor, Synops. des Échin. foss., p, 140, pl. XX, fig. 14-16, 1856. |
| Acrosalenia laevis, |
Desor, ibid., p. 140, 1856. |
| Acrosalenia spinosa, |
Wright, Monog. of the British Foss. Echi-nod. from the Ool. Format., p. 238, pl. XVII, fig. 3 a, b, c, d, e, f, 1857. |
| — — |
Pictet, Traité de Paléont., 2e éd., t. IV, p. 249,1858. |
| — — |
Cotteau in Cotteau et Triger, Échin. Du dép. de la Sarthe, p. 33 et 80, pl.VII, fig. 1 et 2, 1858. |
| — — |
Oppel, Die Juraformation Englands, Frankreichs, etc., p. 457, 1855-1858. |
| — — |
Leymerie et Raulin, Stat. géol. du dép. de l'Yonne, p. 621, 1858. |
| — — |
Cotteau, Note sur la famille des Salénidées, Bull. Soc. géol. De France, 2e série, t. XVIII, p. 621, fig. 5, 1861. |
| — — |
Waagen, Die Jura formation in Franken, etc., p. 79 et 81, 1864. |
| — — |
Bonjour, Cotai, des foss. du Jura, p. 24, 1864. |
| — — |
Huxley and Etheridge, Cat. of Coll. of Foss. in the Museum of Practical Geol., p. 226, 1865. |
| — — |
Ogérien, Hist. nat,. du Jura, t. I, Géologie, p. 736, 1865. |
| — — |
Delbos et Kœchlin-Schlumberger,Descript. géol. et minéral, du dép. du Haut-Rhin, t. I,p.335, 1866. |
| — — |
Mœsch, Der Aargauer Jura, p. 97, 1867. |
| — — |
Greppin, Essai géol. sur le Jura suisse, p. 49 et 55,1867. |
| Acrosalenia spinosa, |
Guillier, Notice géol. et agricole, p. 25, 1868. |
| — — |
Jaccard, Jura vaudois et neuchâtelois , p. 219, 1869. |
| — — |
Wright, On the Correlation of the Jurassic Rocks in the Dep. of the Côte-d'Or with the Ool. Form. Of Gloucester, p. 56, 1870. |
| — — |
Greppin, Jura bernois et districts adjacents, p. 45, 51, 56, 1870. |
| — — |
Desor et de Loriol, Échinol. helvétique, Échinides jurassiques, p. 248, pl. xl, fig. 6-8, 1871. |
| — — |
Cotteau, Oursins jurass. de la Suisse, Bull. Soc. géol. de France, 3e sér., t. I, p. 81, 1872. |
| — — |
Quenstedt, Petrefactenkunde Deutschlands, Echinodermen, p. 251, pl. lxx, fig. 1-4, 1873. |
| — — |
Moesch, Der Südliche Aargauer Jura, p. 36, 1874. |
| — — |
Choffat, Esquisse du Callovien et de l’Oxfordien, p. 94, 1878. |
M. 84.; M. 87. (type de l'espèce). — R. 50. (variété de grande taille). — P. 12. (type de l’Acros. Lœvis).
Espèce de petite taille, subpentagonale, renflée, subhémisphérique en dessus, presque plane en dessous. Zones porifères droites, à fleur du test, formées de pores simples, directement superposés, séparés par un petit bourrelet saillant en forme de cloison, se multipliant un peu près du péristome. Aires ambulacraires étroites, surtout vers le sommet, s'élargissant en se rapprochant de l’ambitus, légèrement renflées, garnies de deux rangées de petits tubercules crénelés et perforés, placés sur le bord des zones porifères, et dont le nombre varie suivant la taille des individus. Ces tubercules s'espacent et diminuent rapidement à la face supérieure; l'intervalle qui les sépare est occupé par des granules serrés, relativement assez gros. Aires interambulacraires munies de deux rangées de tubercules principaux, au nombre de dix à onze par série, crénelés et perforés, largement scrobiculés et très saillants à l’ambitus, diminuant rapidement de volume à la face supérieure. Les plaques interambulacraires qui supportent les tubercules sont un peu bombées et donnent à chaque rangée un aspect légèrement costulé. La zone miliaire qui les sépare, garnie de granules assez développés et serrés à l’ambitus, est plus ou moins nue et déprimée en dessus, Quelques granules de même nature se glissent entre les tubercules les plus espacés de la face supérieure et occupent la zone assez large qui s'étend le long des aires ambulacraires. A la face inférieure, dans certains exemplaires, on remarque, de chaque côté, trois ou quatre granules un peu plus développés et plus distinctement mamelonnés que les autres. Les deux rangées de tubercules aboutissent, près du sommet, à l'angle des aires ambulacraires. Péristome assez grand, s'ouvrant dans une dépression, marqué d'entailles apparentes et relevées sur les bords. Périprocte grand, elliptique, subcirculaire ou subtriangulaire. Appareil apical assez bien développé, subpentagonal, solide, à peine saillant au-dessus du test, finement granuleux, un peu rugueux, composé de cinq plaques génitales perforées, de cinq plaques ocellaires également perforées. et d'une, deux ou trois plaques suranales ; les quatre plaques génitales paires sont pentagonales, allongées, à peu près égales ; la plaque génitale antérieure .de droite présente au milieu un corps madréporiforme presque toujours saillant ; la plaque génitale postérieure impaire est triangulaire, étroite, et moins grande que les autres. Les plaques ocellaires sont petites, triangulaires ; les trois antérieures sont placées à l'angle externe des plaques génitales ; les deux postérieures, un peu plus développées que les autres, aboutissent directement sur le périprocte. La plaque suranale est grande, pentagonale, située à l'angle interne des quatre plaques génitales antérieures ; le plus souvent elle est unique ; quelquefois cependant, elle est remplacée par deux ou trois plaques plus petites.
Hauteur, 7 millimètres; diamètre, 13 millimètres.
Variété de grande taille : hauteur, 8 millimètres ; diamètre, 17 millimètres.
Cette espèce, partout assez commune, présente plusieurs variétés que nous devons signaler. Sa forme est plus ou moins pentagonale, plus ou moins bombée, quelquefois régulièrement hémisphérique. Dans certains exemplaires, la face supérieure est garnie de granules assez abondants ; d'autres fois elle est presque nue, et la zone miliaire, aux approches du sommet, ressemble à celle des Asterocidaris. L'appareil apical est tantôt presque lisse, tantôt finement granuleux; parfois il fait saillie au-dessus du test, tandis que le plus souvent il est superficiel.
Nous avons sous les yeux un exemplaire qui présente un cas pathologique intéressant. A la face supérieure, il n'est muni que de quatre aires ambulacraires complètes. Dans l'aire ambulacraire antérieure, les deux zones porifères font défaut et sont remplacées par une simple suture ; c’est seulement vers l’ambitus et à la face inférieure que l'une des zones porifères, celle de droite, reparaît.
rapports et différences. — L'A. spinosa ne saurait être confondu avec aucun de ses congénères, et sera toujours facilement reconnaissable à ses tubercules interambulacraires très saillants vers l'ambitus, mais diminuant rapidement de volume à la face supérieure et formant deux rangées subcostulées, à sa zone miliaire plus ou moins nue, mais toujours déprimée. Dans nos Echinides de la Sarthe, nous lui avons réuni Acrosalenia laevis, qui ne diffère du type que par sa face supérieure usée et rendant moins apparents les tubercules interambulacraires.
localités. — Sainte-Honorine de Perthes (Calvados) ; environs de Langres (Haute-Marne); Châtelaine, près Arbois (J,ura). Rare. Étage bajocien. — Hérouvillette, Ranville, Luc, Langrune, Lion-sur-Mer (Calvados) ; Hidrequent, Wast, Marquise (Pas-de-Calais) ; Viré (Saône-et-Loire); Sainte-Anne, Sélongey (Côte-d'Or); Perogney (Haute-Marne); Asnières, Châtel-Censoir, Châtel-Gérard hameau des Ferrières près Druyes (Yonne) ; Épeugney (Doubs) ; Nantua (Ain); Monné près Ruillé en Champagne ; Sure (route de Mortagne) ; Marolles-les-Braults (carrière de l'Épine) (Sarthe) ; Sanpans (Jura); environs de Metz (Moselle) ; Villey-Saint-Étienne (Meurthe) ; carrières de Vieux-Ferrette, Bavilliers (Haut-Rhin). Assez commun., Étage bathonien. — Vivoin (Sarthe) ; Prenovel (Jura). Très rare. Étage callovien.
Collection de l'École des mines, de la Sorbonne,. Muséum de Paris (coll. d'Orbigny), coll. Pellat, Babeau, Martin, Schiumberger, .Perron, Morière, Lambert, Desor, .Gauthier, Choffat, Kœchlin-Schlumberger, ma collection.
localités autres que la france. — Schauenbourg, Movelier,Ring, roule de Saint-Braix, Ederschwyler, Graitery, Tramelan, Rohrberg (Jura bernois). — Environs de Soleure. Kornberg près Frick, Zolhaus, Randen (Argovie), Wartenberg près Muttenz. Étage bathonien.— Stonesfield, Sevenhampton. Étage bajocien.. — Sham Castle près Bath,. Minchinhampton, Chippenham, Cirencester (Angleterre). Étage bathonien.
explication des figures. — PI. 238, fi g. 1, A. spinosa, vu de côté, de la collection de M. Pellat ; fig. 2, face supérieure ; fig. 3, face inférieure ; fig. 4, aire ambulacraire grossie; fig. 5, aire interambulacraire grossie ; fîg. 6, appareil apical grossi ; fîg. 7, exemplaire plus petit, de Langrune, vu de côté, de ma collection ; fig. 8, face supérieure ; fig, 9, face inférieure ; fîg. 10, face supérieure grossie ; fig. 11, individu de grande taille, vu de côté, de ma collection ; fig. 12, face supérieure ; fîg. 13, appareil apical grossi, avec trois plaques suranales inégales, pris sur un échantillon de ma collection ; fîg. 14, autre appareil, apical grossi, avec plaque suranale dédoublée, pris sur un exemplaire de ma collection.—PI. 239, fig. 1, A. spinosa,. individu monstrueux, vu de côté; fig. 2, face sup. ; fig. 3,. face inf. ; fig. 4, le même individu grossi, vu sur la face sup.